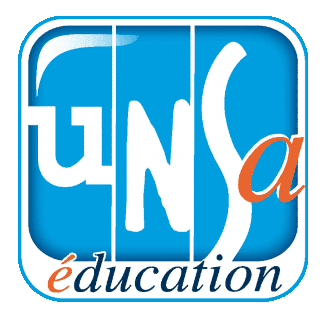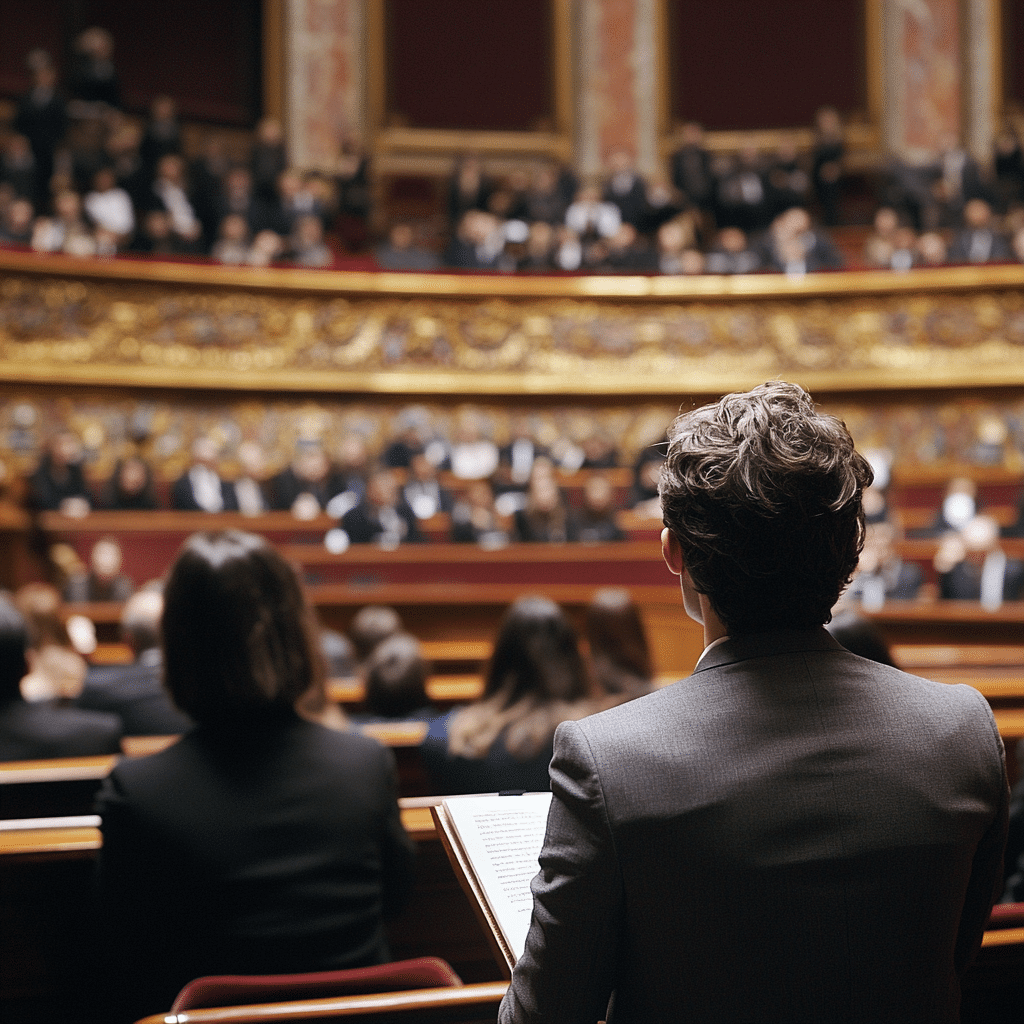Luc Bérille: contre l’austérité,élargir les marges de manoeuvre économiques
Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, a abordé, dans un long entretien qu’il nous a accordé pour l’Éduc’mag* la question des services publics mais aussi le débat sur les solutions pour relancer la croissance. Contrairement aux idées reçues et à quelques postures idéologiques, l’Europe peut être une clé.
L’UNSA, comme la Confédération européenne des syndicats, revendique un plan d’investissement facilitant une croissance vertueuse (transition écologique) et l’emploi durable dans l’Union européenne. C’est ce qui redonnera aux État les marges de manœuvre qui leur font défaut aujourd’hui.
* L’Éduc’mag est la revue trimestrielle de l’UNSA Éducation. Il s’agit du n°141 (novembre 2014). La version que nous publions ici est la version «longue» de l’entretien dont une partie seulement a pu être reprise dans la version imprimée.
Cette version longue peut être téléchargée au format PDF.
Luc Bérille lors d’une manifestion Fonction publique (2014)
L’UNSA, depuis l’origine, défend et entend même promouvoir les services publics. Or, pour les personnels qui y travaillent au quotidien, malgré les discours, la réalité de la «modernisation de l’Administration publique » (la MAP) ressemble beaucoup à la politique du rabot dans laquelle avait sombré la RGPP*.
L’accroissement des déficits accroît la pression sur les pouvoirs publics mais, contrairement aux annonces le souci d’économiser prend le pas sur la réorganisation de la Fonction publique, la réflexion sur son architecture et ses missions. Dans le dossier « décentralisation », les échanges ont eu lieu entre politiques (gouvernement et élus). Il n’y a pas eu de concertation réelle avec les organisations syndicales que ce soit au niveau de la Fonction publique ou au niveau interprofessionnel. Pourtant l’organisation des services publics, au-delà même de la défense des personnels qui y travaillent, nous intéresse en raison de son impact pour l’ensemble des salariés et la population en général.
* RGPP : Révision ou revue générale des politiques publiques.
Parallèlement aux coupes budgétaires émerge ou s’accentue la remise en cause de la fiscalité en elle-même. Jean-Marc Ayrault avait
en son temps annoncé une réforme fiscale avec une remise en plat complète. Elle semble aujourd’hui, tout comme les précédentes, enterrée.
Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, avait effectivement annoncé une réforme fiscale*. La remise à plat qu’elle implique reste, pour l’UNSA, une nécessité, avec deux objectifs.
Le premier est un rééquilibrage entre la fiscalité directe et la fiscalité indirecte, beaucoup plus injuste. Le second est de rétablir une fiscalité citoyenne, avec une imposabilité au premier euro, parce que c’est une condition de sa lisibilité et du principe d’égalité devant l’impôt… qui n’exclut pas, tant s’en faut, une meilleure progressivité de l’impôt direct. Mais c’est une condition de l’acceptation sociale de l’impôt, conforme d’ailleurs à nos principes constitutionnels**. Or, contrairement aux pistes ouvertes par Jean-Marc Ayrault, le renoncement à toute réforme fiscale d’ensemble s’accompagne d’un empilement de la complexité et de l’illisibilité du système.
La suppression annoncée de la première tranche de l’impôt sur le revenu va encore réduire le nombre de foyers imposés qui est déjà inférieur à 50%. C’est d’ailleurs pourquoi l’UNSA est en désaccord avec cette mesure.
* Déclaration de J.-M. Ayrault au quotidien Les Échos (18/11/2013).
** Voir les articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789?
Indépendamment des clés de répartition de la fiscalité, l’impôt rentre moins bien que prévu en raison d’une conjoncture économique atone. Comment stimuler alors l’activité économique pour augmenter
la taille du gâteau à partager ?
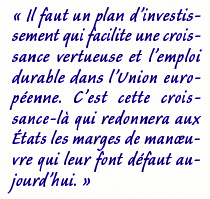
L’analyse de l’UNSA, c’est qu’il y a nécessité absolue d’une initiative de croissance qui s’appuie sur l’Europe. Celle-ci doit faciliter l’élargissement des marges nationales et non enfoncer les États membres dans une spirale dangereusement régressive.
Nous partageons d’ailleurs avec la CES* la revendication d’une inflexion de la politique économique : il faut un plan d’investissement qui facilite une croissance vertueuse et l’emploi durable dans l’Union européenne. C’est cette croissance-là qui redonnera aux États les marges de manœuvre qui leur font défaut aujourd’hui.
* CES : Confédération européenne des syndicats à laquelle appartient l’UNSA.
L’Europe : une clé ? Voilà qui va à l’encontre
de bien des idées reçues aujourd’hui !
Reconnaissons-le, la bataille est difficile. La majorité politique actuelle de l’Europe porte un projet fondé sur l’austérité. Mais le nouveau président de la Commission européenne, issu pourtant de cette majorité, vient de proposer un plan de 300 milliards d’euros pour l’investissement.
Soyons clairs : cela ne suffira pas à régler les problèmes nationaux, mais l’Europe peut et — pour la CES en général et l’UNSA en particulier — doit soutenir une politique de développement. L’Allemagne exceptée, les déficits nationaux sont importants, mais l’Allemagne elle-même est touchée par la stagnation économique.
Il est significatif que M. Juncker, qui appartient pourtant au camp libéral ait été amené, sous la pression des circonstances, à formuler cette proposition que nous prônons nous-mêmes depuis longtemps.
Mais les déficits sont aujourd’hui un frein,
partout ou presque en Europe…
C’est vrai, mais on doit aussi s’interroger sur ce qui est actuellement comptabilisé dans les déficits publics. Pour l’UNSA, la comptabilité purement mécanique des déficits est absurde. Pourquoi y intégrer les dépenses d’avenir que sont l’éducation, l’investissement productif, la recherche et le développement?
Les déficits des États membres sont une réalité, y compris en France, mais l’Union européenne, elle, n’est pas endettée. Elle peut dont recourir à l’emprunt pour jouer son rôle de force d’impulsion. Elle dispose même, avec la Banque européenne d’investissement, d’un outil, d’un support possible.
Concrètement, autour de quoi pourrait tourner
l’initiative européenne de croissance ?
Les réponses à cette question sont évidentes, pour l’Europe comme pour la France. Cette initiative pourrait s’organiser autour de quatre axes.
Le premier, c’est le développement durable autour de la transition énergétique. Cet axe est structurant pour la sortie de crise, d’autant plus que les emplois créés, pour l’essentiel, sont des emplois non délocalisables. Cet axe est de surcroît vertueux. Quand je dis vertueux, ce n’est pas une simple formule rhétorique quand on considère l’intensité et l’urgence des problèmes d’environnement, à commencer par le réchauffement climatique.
Le deuxième axe, ce sont les grandes infrastructures et le troisième concerne l’impulsion pour la recherche et le développement. Il s’agit de penser aux investissements d’avenir d’où le quatrième axe que nous proposons : la formation, et notamment la formation de jeunes. Il y a partout en Europe un accroissement du chômage qui frappe les moins de 25 ans : un jeune actif sur quatre, en France, est sans emploi.
D’où viennent les blocages ?
D’abord d’un manque de décision, et même de volonté politique. L’initiative que propose le président de la Commission — sous réserve évidemment qu’elle ne reste pas lettre morte et que son contenu fasse l’objet d’un dialogue social avec la CES au niveau européen — nous semble intéressante parce qu’elle peut permettre d’inverser les pessimismes nationaux, notamment en France, le sentiment d’être inexorablement enfoncés dans la crise en étant impuissants à la dépasser.
On voit bien l’aspect économique dans ces propositions.
Que devient le social : une marge d’ajustement ?

On vante parfois l’Allemagne, mais on oublie qu’elle subit, je le répète, une stagnation économique et que le revers de sa relative « bonne santé », c’est le développement de la précarité et la pauvreté qui touche un quart de sa population.
La question de la cohésion sociale, en France et en Europe, est une question essentielle. On voit partout, pas seulement dans l’Hexagone, que l’exclusion ou même le sentiment que soi-même ou ses enfants puissent se retrouver sans avenir, est le terreau sur lequel se nourrissent tous les populismes. C’est bien pourquoi la démarche de relance concertée en Europe, en combinant les initiatives que peut prendre l’Union européenne en tant que telle et celles des États membres, doit  marcher sur ses deux pieds où l’économique et le social se confortent. D’où, je le répète, la demande que l’UNSA porte avec la CES d’une croissance vertueuse dans son contenu (transition énergétique, infrastructures, recherche, formation) comme dans sa dimension sociale, avec des emplois durables et qualifiés.
Le « non à l’Europe » est donc une mauvaise réponse…
Tout à fait. La crise que nous subissons est une crise d’évolution structurelle. Certains rêvent de tourner le dos à la mondialisation par le protectionnisme et le repli sur soi. Mais la mondialisation est une réalité et si l’on veut réintroduire des barrières, du protectionnisme, il ne faut pas oublier que les barrières et le protectionnisme fonctionneront dans les deux sens. Or une bonne partie de ce que nous produisons s’exporte : on l’évalue à un emploi sur quatre. C’est plus encore dans certains secteurs comme la chimie, pour prendre ce seul exemple. Sans parler des investissements étrangers en France. Une large partie des produits que nous consommons (l’électronique grand public, la téléphonie) sont importés. Qui se passera de téléphone, de télévision, de tablettes ou d’ordinateurs ?
Il y aurait un risque ?
Absolument, et d’abord le risque de passer à côté du développement des innovations. La technologie des imprimantes en trois dimensions (ce qu’on appelle communément les « imprimantes 3D ») va potentiellement révolutionner une partie de l’industrie, y compris du fait des utilisations à distance, un peu à la manière dont aujourd’hui on peut imprimer un texte depuis un smartphone ou un PC distant en envoyant un simple courriel vers une imprimante Wifi.
Cette évolution va être considérable pour déterminer qui aura des atouts industriels et, plus peut-être que la construction des machines, qui sera en mesure — ou pas — de développer des brevets. Ces outils vont être essentiels dans les industries de précision ou les activités qui peuvent en nécessiter (on voit bien l’intérêt, aujourd’hui, pour le « biomédical sur mesure ») et c’est une source de développement d’emplois très ou hautement qualifiés.
Imprimante 3D à la Cité des sciences (Paris).
Photo Benoît Prieur (Wikimedia Commons)
On entre dans le vif du sujet.
Mais pour faire quoi, avec quelles méthodes ?
Le premier enjeu est la définition des cibles. Il faut apprécier leur validité économique et industrielle. La relance industrielle dans ce pays est nécessaire mais ne se fera pas en imaginant refaire une industrie « à l’ancienne »… qui d’ailleurs n’existe plus. Cela implique, en France notamment, d’agir sur les « montées en gamme ». Dans les comparaisons France/Allemagne, c’est un écart bien connu, mais pas insurmontable. En tout cas, c’est bien avec du haut de gamme que les économies développées peuvent produire de la valeur ajoutée.
Il faut aussi mener, ou plutôt conclure, la réflexion sur les filières industrielles. On est généralement dans des relations, d’ailleurs très inégalitaires, entre donneurs d’ordre et sous-traitants. Il est aujourd’hui plus productif de chercher à rassembler l’ensemble des acteurs dans un schéma coopératif. Pour l’industrie automobile, y compris par rapport à l’enjeu sur les montées en gamme que j’évoquais, c’est une réflexion d’ensemble sur la recherche et le développement, la synergie producteurs/équipementiers, bref, un schéma coopératif nécessaire pour redynamiser l’industrie.
Ça suppose évidemment, quand on sait comment agissent aujourd’hui les donneurs d’ordre vis-à-vis des autres entreprises, un cap à franchir. Mais de plus en plus d’entreprises sont « intégrées ».
Parler d’industrie quand on a évoqué la transition énergique peut surprendre.

Ces changements auront des conséquences sur les modalités de travail et les qualifications professionnelles. Il faut anticiper sur l’aspect social de cette question : comment, en amont, va-t-on préparer, organiser la transition professionnelle des salariés ? Prenons l’exemple des énergies fossiles : la baisse de leur utilisation doit être l’occasion de faire évoluer les salariés des branches concernées (énergie, chimie, transports…).
L’ampleur des changements suppose des investissements massifs.
On peut douter que ça se fasse tout seul : la frilosité des banques est un sujet évoqué par les chefs d’entreprise eux-mêmes.
C’est une question où la volonté politique est essentielle. D’abord pour redonner aux entreprises, plus largement aux branches, des capacités d’investissement qui leur font aujourd’hui défaut. Ou alors, il faudrait regarder passer le train de la transition énergétique et écologique sans espoir pour l’avenir.
Il faut donc un appui financier à l’investissement productif et innovant qui interroge effectivement aujourd’hui sur le rôle des banques. La création de la Banque publique d’investissement, la BPI, offre un cadre intéressant, y compris parce qu’elle associe les régions à son action et que cette synergie peut être porteuse pour la création et le développement de PME-PMI innovantes. Or ce sont elles aujourd’hui qui créent, plus que les grands groupes, des emplois. Mais, pour intéressante qu’elle soit, l’existence de la BPI ne doit pas servir d’alibi à l’absence de réflexion mais aussi d’action des pouvoirs publics en direction des banques pour qu’elles assument ce qui fait partie de leur rôle traditionnel : le financement de l’économie. C’est un enjeu majeur pour un développement économique générateur d’emplois.
Si on parle d’emplois créés, on parle de recrutements.
Et les jeunes dans tout ça ?
Pour les jeunes, la question de départ est bien celle du niveau de formation et de qualification. Même si la crise actuelle de l’emploi accentue les difficultés pour tous, les diplômes, et notamment ceux de l’enseignement supérieur protègent davantage. Mais nous traînons toujours l’inacceptable boulet des 150 000 jeunes qui quittent chaque année le système éducatif sans diplôme ni qualification. C’est un problème qui n’est pas seulement éducatif, culturel ou social : c’est, comme l’illettrisme, un problème économique.
L’UNSA, on le sait, est très attachée au développement de la formation tout au long de la vie. Mais l’UNSA sait aussi combien est déterminant le rôle du bagage que représente la formation initiale pour l’avenir des individus. Cela a des incidences quand on sait ce qu’est aujourd’hui l’organisation du travail, quand on sait surtout que les parcours professionnels ne s’effectuent plus selon le modèle un métier/une entreprise.
Nous portons depuis des années une volonté, celle de sécuriser les parcours professionnels y compris par la portabilité des droits. La formation tout au long de la vie est une nécessité, mais elle doit reposer sur une formation initiale qui donne à tous un socle solide pour tenir compte à la fois des changements de métiers et des changements d’entreprise qui toucheront tous les salariés.
Image tirée du blog «École de demain» (SE-UNSA)
Pourquoi cette question du socle commun est-elle si importante pour une organisation interprofessionnelle comme l’UNSA ?
Tout simplement parce qu’elle est déterminante à chaque fois que le salarié aura besoin de faire évoluer sa qualification, parce que les techniques et les procédés eux-mêmes évoluent. Un socle insuffisant aggrave les drames sociaux parce qu’il intervient comme un obstacle parfois infranchissable dans les dispositifs de requalification (y compris au sens de «trouver une autre qualification»).
La question n’est pas nouvelle : il y a plus de quarante ans, Bertrand Schwartz y travaillait déjà, mais elle prend un tour beaucoup plus préoccupant aujourd’hui où les entreprises ont besoin de niveaux de qualification plus élevés et où les changements s’accélèrent.
J’évoquais tout à l’heure l’incidence vraisemblable des technologies d’impression « 3D », mais personne aujourd’hui ne saura de quelle manière cela se traduira dans les trente prochaines années, de la même manière que personne ne pouvait prévoir en 1960 ou même 1970 ce que deviendrait l’utilisation, quotidienne pour nous, de l’outil informatique.
Demain encore plus qu’aujourd’hui la capacité à retrouver un travail sera liée à la capacité à se requalifier ou à changer de métier. Le retour à l’emploi sera plus difficile si le socle de compétences (j’inclus dans les compétences le savoir « mis en action ») est défaillant. C’est tout l’enjeu de la transformation de l’École, au-delà de la permanence de son rôle en matière de diffusion d’une culture humaniste à laquelle ne nuirait d’ailleurs pas le fait qu’elle soit en mesure d’assumer davantage « l’espérance républicaine d’une École démocratique ».
Dans l’immédiat, il faut renforcer l’accès aux formations en alternance. D’abord parce qu’il faut agir pour qualifier ou mieux qualifier les jeunes notamment, sauf si on veut les voir sombrer dans des trappes à inactivité. Il faut considérer aussi qu’elle relève d’une conception de la formation  qui développe un processus d’acquisition en articulant les apports théoriques et pratiques. Je note d’ailleurs qu’elle se développe au-delà de ce qui était son champ traditionnel : le niveau V*. Dans ce domaine, il est avéré que les universités elles-mêmes progressent. Il faut, par rapport à la formation traditionnelle sous statut scolaire (ou universitaire) dépasser les oppositions (et sans doute, de part et d’autres, les préjugés ou présupposés) et penser les choses en termes de complémentarité.
* Le niveau V correspond au niveau CAP/BEP.
Bouclons la boucle et reparlons des services publics. Nous avons une petite idée des sommes qu’il faudra injecter dans l’économie. Alors, quid du service public, cette charge intolérable aux yeux de certains ?
L’opposition public/privé (dans laquelle le service public serait coupable de tous les vices et le privé paré de toutes les vertus) relève de conceptions bloquantes (comme inversement chez les adeptes du tout-État).
Un certain nombre de questions relèvent logiquement des entreprises privées. Elles assument ou doivent assumer en la matière leurs responsabilités. Mais, dans le domaine économique concurrentiel lui-même, le fait de s’appuyer sur une action publique forte pour l’adaptation aux évolutions nécessaires est un point d’appui indispensable, sans parler même de la régulation nécessaire.
On devrait d’ailleurs insister davantage sur le rôle de l’État-stratège par exemple sur des questions comme mondialisation/régulation ou efficacité économique/démocratie. L’État-stratège, c’est la direction stratégique générale, le conseil mais aussi le contrôle puisqu’il est responsable de l’intérêt général.
Intérêt général, public, privé : comment fait-on ?

C’est un vrai débat politique avec un grand P, un vrai débat d’orientation politique à soumettre aux citoyens avec la contribution de la société civile. Or ces questions sont peu ou pas assumées aujourd’hui, alors même qu’elles se renouvellent.
Peut-on préciser ce que peut représenter ce renouvellement ?
Après la Seconde Guerre mondiale, on a procédé à des nationalisations : on voit bien aujourd’hui que, globalement, cette solution qui correspondait à une économie plus réellement « nationale » n’aurait guère de sens.
En revanche, toujours à la Libération, on a instauré la Sécurité sociale — avec ses limites de l’époque, qu’on oublie parfois, d’ailleurs. Mais aujourd’hui, on sait qu’apparaît de manière massive un « risque » nouveau, celui de la perte d’autonomie liée à l’âge.
C’est une question qui ne se posait que marginalement il y a trente ans encore parce que l’espérance de vie était beaucoup plus faible. Mais aujourd’hui, nous sommes confrontés à la question de plein fouet : prise en charge « libérale » ou socialisée ? Rester dans l’entre-deux, c’est ne pas choisir et laisser imposer la loi du marché. Mais ça suppose, pour tous les acteurs concernés (y compris les organisations syndicales) d’assumer le choix stratégique de la prise en charge, y compris les conséquences douloureuses, pour les uns ou les autres, du mode de financement. Pour ce qui nous concerne, nous préconisons résolument le choix de la solidarité.
Nous arrivons au terme de l’entretien. Que dire en guise de conclusion ?
Aujourd’hui, la crise nous oblige à mêler et les réponses aux difficultés du moment, et la préparation à des évolutions structurelles lourdes. Pour l’UNSA, l’objectif reste de développer l’emploi et de préserver les grands axes du modèle social. Il peut ou il doit évoluer, mais dans le respect de ses principes fondateurs. C’est tout l’enjeu de la période.
On peut jouer à faire semblant, parce que revendiquer ne coûte pas cher, ou essayer, modestement mais avec détermination, d’agir pour que les choix stratégiques soient les bons et que les chemins tracés —  souvent dans la difficulté et parfois dans la peine — conduisent les salariés ou la société ailleurs que dans une impasse. L’UNSA a fait son choix.
Propos recueillis par Luc Bentz (13/10/2014)