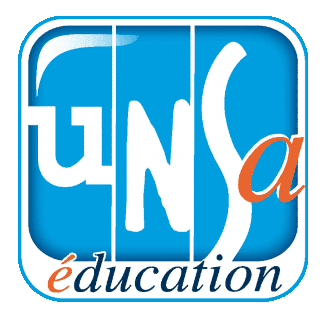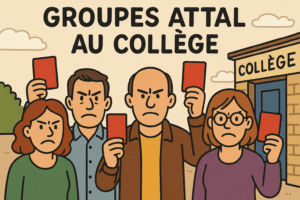Liberté, égalité, … sécurité

« Loi Immigration » de janvier 2024, changement de logiciel
Malgré la censure de trente-deux articles par le Conseil Constitutionnel pour motif de procédure (en tant que « cavaliers législatifs » : articles sans lien suffisant avec le texte initial) et de trois articles sur le fond (en partie ou en entier), l’esprit du texte a choqué les progressistes par son fond réactionnaire. Dans le lot des nombreuses dispositions retoquées, on peut citer l’instauration de quotas migratoires, l’exigence d’une durée de séjour régulier imposé aux étrangers pour l’accès à certaines allocations (aides personnelles au logement -APL, allocations familiales…), le durcissement du regroupement familial ou les restrictions sur l’accès au séjour des étrangers malades.
Le satisfecit du RN n’était alors qu’un prélude à l’entente objective qui suivra entre le pouvoir et l’extrême-droite après la chaotique séquence électorale post dissolution. En surfant sur la vague populiste qui déferle depuis quelques années sur l’Europe et sur le monde, le pouvoir a tourné le dos aux valeurs fondamentales d’égalité et de fraternité qui soutiennent pourtant aux côtés de la liberté notre modèle républicain.
La tentation du populisme
En septembre 2024, le ministre de l’Intérieur avait déjà affirmé que l’État de droit n’était ni « intangible » ni « sacré » en invoquant de manière démagogique le recours direct au peuple en toutes circonstances. Il méprisait alors des décennies de construction démocratique de l’État de droit qui assure pourtant l’égalité de tous devant la loi, l’indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs. Ce sont les fondements de notre République démocratique issue de l’esprit des Lumières et de l’héritage de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Ces principes permettent justement l’exercice effectif d’une véritable démocratie.
Cette conception contrevient, par ailleurs, à la démarche européenne. En effet, depuis 2009, d’après le préambule de la Charte des droits fondamentaux l’UE consacre le principe de l’État de droit (avec la démocratie), comme l’un des piliers sur lesquels elle repose.
C’est donc in fine en jouant le jeu d’une pseudo démocratie directe et en sacralisant les émotions immédiates de l’opinion que le ministre compte bâtir sa doctrine politique.
La sécurité avant tout
Loin de réduire le RN et ses idées comme il l’avait déclaré lors de sa prise de fonction, le président de la République préfère s’adapter à l’idéologie réactionnaire ambiante en donnant des gages à l’extrême-droite sur ses sujets de prédilection. Jamais, le RN n’aura autant dicté son tempo et son agenda.
Les décisions les plus emblématiques sont souvent prises en matière de sécurité pour éviter de traiter les problèmes de fond et de mettre les moyens nécessaires aux maux profonds qui frappent notre société dans le domaine économique et social. C’est ainsi qu’on ne retiendra en matière d’éducation que la déclaration improvisée de la ministre de l’Éducation nationale, Elisabeth Borne, sur les fouilles inopinées de sacs par les forces de l’ordre à l’entrée des établissements scolaires. Même si cette mesure peut avoir un intérêt, force est de constater que c’est d’abord et avant un objet de communication qui consiste à montrer un gouvernement au travail qui agit pour la sécurité et le bien-être de la population. Comme toujours, il est question d’image sans se soucier de la faisabilité et évidemment sans prendre l’avis des acteurs de terrain. L’influence de la thématique sécuritaire est un marqueur fort pour la droite mais il tend à gagner une grande partie de l’arc républicain.
La création des services de défense et de sécurité académiques dans chaque rectorat semble suivre cette même logique. L’objectif est louable car il s’agit de renforcer la gouvernance académique de la défense et de la sécurité dans un contexte « d’importance accrue des enjeux régaliens au sein de l’institution scolaire ». Pourtant, quid des moyens associés ? Le contexte généralisé de restriction budgétaire ne nous rend pas optimistes. De plus, l’adhésion aux valeurs de la République est éminemment liée à l’éducation, à la formation à l’information. Accoler le mot « défense » peut rassurer en théorie mais cela ne fait pas une politique de promotion du modèle républicain.
L’instrumentalisation du principe de laïcité
L’instrumentalisation systématique du principe de laïcité est aussi dangereuse que révoltante. En cette année où la loi de séparation fête ses 120 ans, les initiatives bassement politiciennes sont particulièrement choquantes.
- Qu’il s’agisse des déclarations sur la question du voile à l’université ou de l’interdiction des signes religieux dans le sport, une grave confusion est en train de s’opérer entre la lutte ciblée contre une religion et le respect du principe de laïcité.
- Depuis 1905, les principes de la loi garantissent la liberté de conscience et de culte, l’égalité de tous devant la loi et la séparation stricte des Églises et de l’État. L’école, en tant que lieu de formation, est un espace privilégié qui a d’ailleurs connu les bienfaits de la laïcisation dès les années 1880, bien avant l’État. Voir notre podcast cadre juridique de la Laïcité.
- A l’université, comme chacun sait, la liberté de jeunes adultes s’applique, y compris en matière religieuse, sans dévoyer évidemment l’esprit de la loi. C’est un service public subordonné à l’égalité, à la neutralité et au principe de laïcité. Des référents laïcité établissent des rapports annuels sur l’application du principe de laïcité comme décrit dans le guide la laïcité à l’université. Ce sujet qui ne fait pas polémique sur les campus est une fois de plus instrumentalisé par les réactionnaires pour viser une communauté sous couvert de défense des principes républicains. Dès lors, la surenchère est lancée et on évoque même ici ou là des interdictions de signes religieux dans l’espace public. On enfreint donc la loi et on dénature le principe de laïcité au nom de cette même laïcité… un comble.
- Il en va de même avec la proposition d’interdiction du port de signes religieux dans les compétitions sportives. L’objectif affiché est de lutter contre le séparatisme. Mais ce n’est pas en invisibilisant la pratique religieuse (des femmes) que l’on pourra lutter efficacement contre le séparatisme. Des plans de formation existent mais il faudrait pouvoir les appliquer partout pour tous. Cet enjeu de formation est essentiel et va bien au-delà d’une interdiction qui ne règle le problème qu’en apparence. Nombre de voix se sont déjà élevées. Nicolas Cadène craint, par exemple, une « légalisation des discriminations » ce qui recoupe les inquiétudes des experts du groupe de travail « discrimination à l’égard des femmes » de l’ONU. Les pays voisins ne comprennent pas ce qu’ils voient comme une disposition liberticide et on ne peut que comprendre leur circonspection… Sur le fond, la plupart des craintes sont déjà couvertes par la loi au nom de la séparation. C’est le cas des risques de détournement des équipements sportifs à des fins cultuelles. Mais se fonder sur la laïcité pour interdire un signe religieux dans le sport n’a pas grand sens dans la mesure où ce principe suppose la neutralité de ceux qui représentent l’administration publique et non des usagers. C’est une garantie de l’égalité du service pour tous. Le cas de l’école que l’on invoque souvent à titre de comparaison n’est pas très judicieux. Il fait l’objet d’un traitement particulier au regard de ce qui s’y joue en termes de formation, d’apprentissage, de développement de l’esprit critique ; en somme en termes d’émancipation. En 2023, le Conseil d’État avait déjà explicité la neutralité du service public pour les athlètes sélectionnés par les fédérations sportives du fait de la délégation de service public. Quant au reste des compétitions sportives, le Conseil d’État ne voit aucune interdiction à prescrire au titre de la laïcité.
Nous sommes là encore, de facto, dans une incantation de nature idéologique qui passe à côté du véritable enjeu. La question du séparatisme dans le milieu du sport est effectivement une véritable menace pour notre République. Voir notre Podcast laïcité et Sport.
Pour l’UNSA Éducation, il faut sortir de cette politique du paraître qui se nourrit de la poussée populiste et réactionnaire mondiale.
Pour notre fédération, faire cohésion est un enjeu majeur mais pour ce faire, il faut se donner les moyens de lutter réellement contre les affres de la division et les dangers du séparatisme.
- S’attaquer au séparatisme, c’est réconcilier les jeunes et les déçus du pacte républicain avec nos valeurs et nos principes fondamentaux.
- S’attaquer au séparatisme, c’est valoriser celles et ceux qui font tout pour s’extraire d’une situation difficile, des pesanteurs socio-culturelles ou de traditions écrasantes.
- S’attaquer au séparatisme, c’est valoriser, défendre et promouvoir l’école publique laïque en cessant d’allouer plus de 10 milliards de fonds publics à l’enseignement privé (essentiellement catholique) en organisant une concurrence déloyale.
- S’attaquer au séparatisme, c’est lutter effectivement contre la ségrégation en démantelant les ghettos de pauvres et en enrayant l’entre-soi des ghettos de riches.
- S’attaquer au séparatisme, c’est refaire de la mixité sous toutes ses formes qui plus est dans les lieux de formation ou d’échanges entre jeunes.
- S’attaquer au séparatisme, c’est ne pas abandonner l’une des valeurs cardinales de notre devise républicaine : la fraternité.