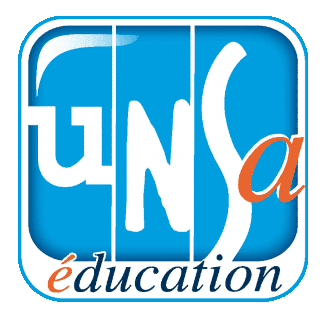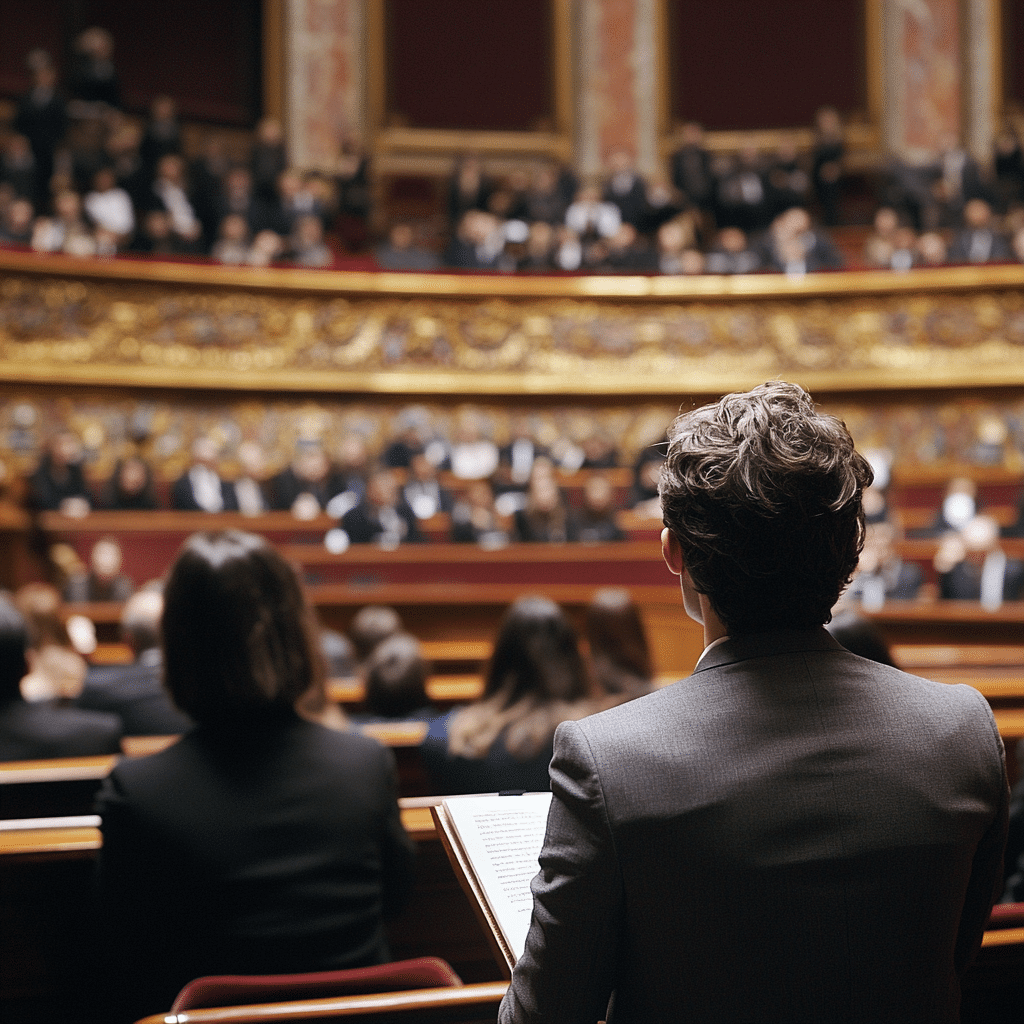Les 20 ans de la loi handicap : un bilan contrasté

Il y a 20 ans, dans le code de l’action sociale et des familles, une définition du handicap inspirée de la classification internationale du handicap était introduite.
Tous les handicaps qu’ils soient moteur, sensoriel, cognitif, mental, psychique, y étaient pris en compte. Cette réforme majeure visait à renforcer l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de l’accessibilité.
Avant cette loi, les droits des personnes handicapées étaient régis principalement par la loi du 30 juin 1975, portée par Madame Simone Veil, ministre de la santé, qui reconnaissait leur droit à la solidarité nationale mais restait limitée dans l’application concrète de l’accessibilité et de l’inclusion et a instauré la politique publique sur le handicap.
La loi du 11 février 2005 a marqué un changement profond et un tournant législatif important en ne prenant plus « en charge », mais « en compte » la personne et en introduisant des principes forts :
- Le droit à la compensation du handicap via la Prestation de Compensation du Handicap (PCH),
- L’accessibilité universelle avec l’obligation d’adapter les bâtiments publics et les transports,
- L’école inclusive, avec la scolarisation des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire,
- L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, avec un quota de 6 % dans les entreprises de plus de 20 salariés.
Vingt ans plus tard, ces droits et cette reconnaissance sont toujours sont toujours présents. L’UNSA Éducation fait le constat que :
- Le taux d’emploi des personnes en situation de handicap est passé de 2,82 % en 2014 à 4,09 % en 2024 avec une augmentation du recrutement.
- Les agents bénéficient d’un suivi individualisé tout au long de leur carrière, incluant la définition de projets professionnels adaptés, des aménagements de poste, des dispositifs spécifiques d’adaptation (allègement de service, affectation sur poste adapté) et un accompagnement au reclassement en cas d’inaptitude ou de risques d’usure professionnelle.
- La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) a permis d’améliorer l’accompagnement des personnes concernées.
- Depuis 2020, un décret permet aux agents en situation de handicap de conserver leurs équipements de travail lors d’une mobilité, facilitant ainsi leur adaptation à un nouveau poste.
- Des améliorations en matière d’accessibilité des infrastructures publiques et des transports ont été réalisées, même si des retards subsistent.
- Le nombre d’enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a triplé, atteignant 436 000 élèves en 2024.
- Le rôle des AESH (Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap) a été renforcé, bien que leur statut demeure précaire.
Cependant, malgré ces avancées majeures, les objectifs fixés en 2005 sont loin d’être atteints et des défis restent encore à relever pour assurer une inclusion véritable et équitable des agents en situation de handicap au sein de nos ministères :
- Des délais d’accès aux droits trop longs, notamment auprès des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) qui peinent à répondre rapidement aux demandes d’aide et d’aménagements,
- Un taux d’emploi des personnes en situation de handicap bien inférieur à 6 %,
- La faible application de mise en œuvre de l’article 93 de la loi de transformation de la Fonction Publique, qui permet aux agents en situation de handicap d’accéder à des corps ou catégories supérieurs par voie de détachement. Cette disposition mal comprise et peu mise en œuvre, maintenant ainsi le retard de carrière des agents handicapés.
- La professionnalisation des agents dans le domaine du handicap reste insuffisante, limitant leur capacité à adapter leurs pratiques professionnelles aux besoins spécifiques des agents en situation de handicap,
- Une mauvaise coordination entre les différents acteurs impliqués dans l’accompagnement des agents en situation de handicap qui peut entraîner des parcours professionnels discontinus et des difficultés dans la mise en place des aménagements nécessaires.
- Une accessibilité encore insuffisante, de nombreux établissements et infrastructures restant inadaptés aux personnes en situation e handicap,
- Une inclusion scolaire incomplète, avec un manque de moyens, une formation insuffisante des enseignants et le statut précaire des AESH, qui fragilise la scolarisation des élèves en situation de handicap,
- Des inégalités dans l’accès à l’emploi, avec un taux de chômage des personnes handicapées encore élevé (12 % contre 7 % pour la moyenne nationale).
L’UNSA Éducation demande le respect de l’obligation légale d’employer au minimum 6 % de personnels en situation de handicap, la mise en place d’un plan d’action ministériel relatif à l’inclusion des personnels en situation de handicap concret avec des engagements financiers et humains à hauteur des besoins, une formation des correspondants et référents handicap ainsi qu’une reconnaissance officielle de leur rôle, l’application de l’article 93 de la loi de transformation de la Fonction publique pour faciliter la promotion interne, un renforcement des moyens pour une école réellement inclusive, une amélioration du statut des AESH, un accompagnement digne pour chaque élève en situation de handicap, une accélération des mises aux normes d’accessibilité des services publics et un soutien plus fort à l’insertion professionnelle et à l’emploi des personnes en situation de handicap.
Si la loi du 11 février 2005 a marqué une avancée historique, 20 ans après, le bilan est mitigé. Bien que la prise en charge intégrale de l’achat d’un fauteuil roulant vient d’être récemment annoncée et que les Jeux Paralympiques de Paris ont contribué à sensibiliser davantage le grand public à la question du handicap. Cette mobilisation n’a que peu influencé les politiques publiques, laissant inchangées de nombreuses difficultés d’accessibilité, notamment dans les transports, où 75 % restent inadaptés.
L’UNSA Éducation appelle à un engagement plus fort des pouvoirs publics et notamment de nos ministères. Une prise de conscience est nécessaire afin de lutter contre l’exclusion, la discrimination et la marginalisation des personnes en situation de handicap. Cette prise de conscience doit se traduire par des mesures concrètes. Si la loi du 11 février 2005 affirme l’égalité des droits et des chances pour les personnes en situation de handicap, il reste encore beaucoup à accomplir pour la garantir. L’inclusion réelle reste un défi. Aujourd’hui, l’UNSA Éducation participe au GT au sein du ministère pour que les choses bougent !