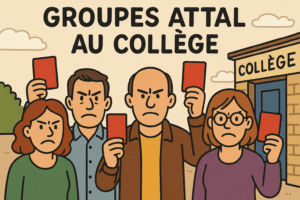Affectation dans le supérieur : un bref historique

Ainsi, dès les années 2000, les pouvoirs publics ont eu recours à des procédures de plus en plus automatisées et nationales. En 2003 est créée la plateforme d’accès aux classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) www.admission-prepas.org [3] qui servira de base en 2009 au déploiement d’Admission Post Bac, APB, pour réaliser l’affectation de l’ensemble des néo-bacheliers dans les formations du supérieur. Ces deux algorithmes reposent sur un appariement entre les vœux hiérarchisés des candidats et les places offertes dans les formations ; algorithme connu sous le nom d’algorithme pour le problème des mariages stables [4] ou algorithme de Gale et Shapley, du noms des deux chercheurs qui l’ont proposé en 1962 [5].
La différence principale entre ces deux systèmes d’affectation réside alors dans le fait que APB devait prendre en compte des formations -les Licences dans les universités- qui, contrairement aux CPGE, ne sont pas sélectives. Il n’existait donc pas de possibilité de classement entre les futur·e·s étudiant·e·s sur leurs vœux en Licence ce qui vint à poser problème lorsque la demande sur certaines mentions dépassait fortement l’offre des établissements. Après avoir essayé, par l’adjonction de différents critères, de départager les candidat·e·s sur ces formations dites en tension, le gouvernement entérine dans une circulaire parue au bulletin officiel le 27 avril 2017 [6], le recours au tirage au sort pour “arrêter un choix entre des candidats ayant un même ordre de priorité”.
Très rapidement, des contentieux sont portés devant des tribunaux administratifs, dont celui de Bordeaux qui annule le refus d’admission en STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) d’une étudiante [7] et devant la CNIL (commission nationale de l’informatique et des libertés) qui met en demeure le gouvernement pour qu’il remédie sous trois mois au dysfonctionnements d’APB. Notamment, la CNIL enjoint le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche de : cesser de prendre des décisions produisant des effets juridiques à l’égard des personnes sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ; en particulier, prévoir une intervention humaine permettant de tenir compte des observations des personnes [8]. Le conseil d’État annulera définitivement la circulaire introduisant le tirage au sort par une décision rendue le 22 décembre 2017 [9]. Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche se voit alors contraint de mettre en place une nouvelle procédure d’affectation, humaine et non automatisée, sans tirage au sort, pour la rentrée de 2018. Ainsi est développée la nouvelle plateforme d’affectation Parcoursup.

La mise en place de cette nouvelle plateforme est portée par la loi orientation et réussite des étudiants (loi ORE [10]) mais celle-ci vise aussi des changements plus profonds dans le supérieur et sera également suivie d’une réforme du lycée et du baccalauréat. L’ensemble des ces lois forment le Plan Étudiants voulu par le gouvernement d’Edouard Philippe [11]. La loi ORE introduit les attendus que chaque formation affiche afin de, théoriquement, mieux guider les lycéennes et lycéens dans leur choix d’orientation. Les formations de licence proposent des classements des candidats selon des critères locaux et peuvent offrir des parcours de remédiation aux élèves les plus fragiles scolairement ou éloignés des attendus. Les licences ont donc la possibilité de répondre Oui ou Oui, si aux candidates et candidats ; le si conditionnant le suivi d’un parcours adapté : année supplémentaire, cours de soutien, etc. Rappelons donc que les licences ne peuvent répondre Non à une candidature, cependant, des capacités d’accueil inférieures à la demande peuvent conduire à ce que des candidats n’intègrent jamais la liste principale durant la période de choix.
Ces parcours plus ou moins personnalisés ont pour but d’améliorer la réussite des étudiant·e·s en licence. Le Plan Étudiants est aussi censé améliorer les dispositifs d’orientation des lycéens. Ainsi, en terminale, deux semaines sont théoriquement dévolues à l’orientation, un·e deuxième professeur principal accompagne les élèves et les conseils de classes passent plus de temps sur les projets professionnels des élèves. Notons que si la loi prévoit effectivement deux semaines dédiées à l’orientation en Terminale, peu de moyens sont donnés pour les rendre effectives et les situations sont très hétérogènes d’un établissement à un autre.
Deux ans après la promulgation de la loi ORE et du déploiement de Parcoursup, la cour des comptes en faisait un bilan assez mitigé [12] et écrivait en synthèse que : “Quatre constats s’imposent. La fonction d’orientation dans l’enseignement secondaire, en dépit de progrès notables, est la grande oubliée de cette réforme. La plateforme Parcoursup fonctionne de manière satisfaisante, mais s’expose à des risques qui doivent être impérativement réduits. La procédure d’affectation souffre encore d’un défaut de transparence, seule garante de l’équité. La réussite étudiante, quant à elle, largement financée, fait l’objet d’un manque de suivi qui compromet, in fine, la mesure de son éventuel succès”. Nous devons également rappeler les recommandations du défenseur des droits, saisi par plusieurs syndicats et élus, pour plus de transparence et sur les évaluations locales [13].
Si du travail reste à mener pour améliorer la plateforme et répondre aux questions justifiées qu’elle suscite, nous pouvons constater que celle-ci évolue d’année en année. On peut voir, par exemple, que la description de la procédure informatique de Parcoursup est disponible sur le site du ministère [13], que les informations données aux candidates et candidats sont de plus en plus complètes, et que le calendrier est enfin synchronisé sur les épreuves du baccalauréat [14]. Il reste cependant à continuer le travail sur la publicité des méthodes locales de lecture et d’évaluation des candidatures.
Références : [1] https://www.vie-publique.fr/discours/150779-declaration-de-m-jean-pierre-chevenement-ministre-de-leducation-natio [2] https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/documents/STRANES_entier_bd_461122.pdf [3] https://www.lemonde.fr/societe/article/2003/01/07/les-nouvelles-procedures-pour-s-inscrire-en-prepa-en-2003_304616_3224.html [4] https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/mariages-stables.pdf [5] https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Gale_et_Shapley [6] https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo17/MENS1710767C.htm [7] http://jurista33.fr/dotclear/index.php/?post/2017/10/03/Acc%C3%A8s-%C3%A0-l-Universit%C3%A9-tirage-au-sort [8] https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000035647959/ [9] https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2017-12-22/410561 [10] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036683777 [11] https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-plan-etudiants-accompagner-chacun-vers-la-reussite-49270 [12] https://www.ccomptes.fr/fr/publications/acces-lenseignement-superieur-premier-bilan-de-la-loi-orientation-et-reussite-des [12] https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=more_results&autolevel1=1 [13] https://services.dgesip.fr/fichiers/presentation_algorithmes_parcoursup_2022.pdf [14] https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/parcoursup-2023-une-information-plus-claire-plus-riche-et-plus-transparente-343939
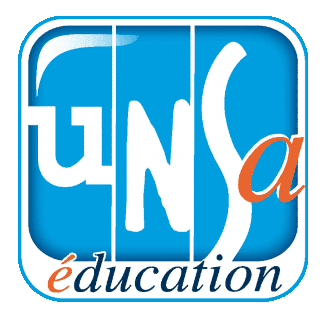
 Analyses et décryptages
Analyses et décryptages