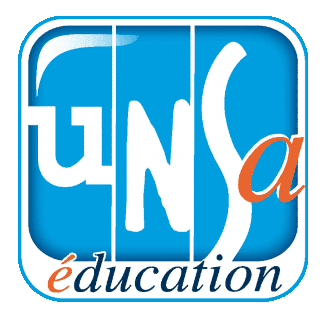Montpellier dossier écoféminisme : un peu d’histoire …
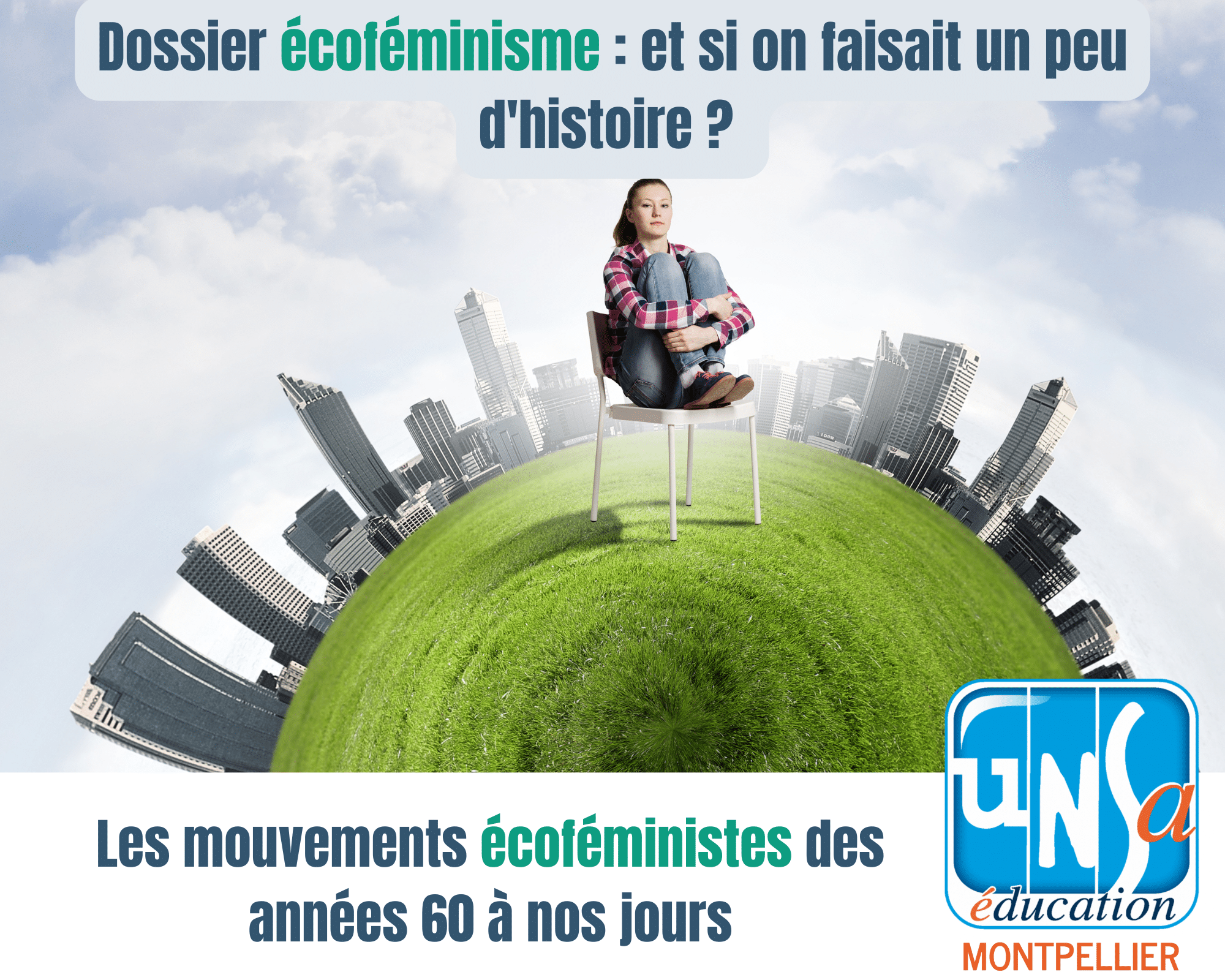
Aux Etats-Unis et en Angleterre
En 1962, suite à la publication du Silent Spring de la biologiste américaine Rachel Carson, toute une frange de la population occidentale prenait conscience des enjeux écologiques entourant les pesticides ; en 1972, quatre jeunes scientifiques du MIT rédigent à la demande du Club de Rome un rapport qu’ils intitulent Les limites de la croissance, dit le Rapport Meadows : leur recherche établit les conséquences dramatiques d’une croissance exponentielle des activités humaines dans un monde fini. Face à ces prédictions désastreuses, émerge une conscience environnementale dans la foulée des mouvements sociaux pour les droits des Noir·es américain·es, des femmes, des Amérindien·nes des années 1960. L’écoféminisme connait son essor aux États-Unis et Royaume-Unis là où la contestation anti-nucléaire bat son plein au début des années 80.
L’écoféminisme est initié par des femmes de ces mouvements faisant le lien entre l’exploitation des ressources naturelles et leur exploitation. En mars 1979, en Pennsylvanie, l’accident à la centrale nucléaire de Three Mile Island amène des femmes militantes de différentes idéologies – notamment les « radicales », les « marxistes » et les « sectatrices de la Déesse » – à se rassembler et à fonder le mouvement Women and Life on Earth. Afin de concilier leurs convictions diverses, elles établissent une Déclaration d’unité : «Nous sommes des femmes qui se sont réunies pour agir d’un commun espoir en des temps de peur. Nous abordons les années 1980 dans un cri d’alarme pour le futur de notre planète. Les forces qui contrôlent notre société menacent notre existence avec l’armement et l’énergie nucléaire, les déchets toxiques et l’ingénierie génétique.[…] Nous voyons des liens entre l’exploitation et la brutalisation de la terre et de ses populations d’un côté, et la violence physique, économique et psychologique perpétrée quotidiennement envers les femmes. Nous voulons comprendre et tenter de surmonter les divisions historiques basées sur la différence de race, de degré de pauvreté, de classe sociale, d’âge et de sexe.». La première manifestation écoféministe d’envergure a lieu le 17 novembre 1980, à Arlington en Virginie : Women’s Pentagon Action. Des milliers de femmes convergent vers le Pentagone, lieu de la « puissance impériale qui nous menace tous et toutes (1) ». Elles affirment «craindre pour la vie de notre planète, la Terre, et la vie de nos enfants, qui sont notre futur». Quatre grandes mascottes géantes défilent au milieu de 2 000 personnes qui chantent, crient, jettent des sorts et tapent sur des tonneaux de fer. Elles rendent hommage à toutes celles qui moururent sous les coups de la société de l’époque: « une machine de guerre et de productivisme (2) ». Plus de 140 femmes sont arrêtées.
Un an plus tard, en Angleterre, le camp Greenham Common Women’s Peace Camp est érigé par 36 femmes contre l’installation de missiles nucléaires sur la base Royal Air Force du même nom. Ce camp est occupé de 1981 jusqu’en 2000, date de son démantèlement. Il attire à certains moments des dizaines de milliers de personnes, comme le 1er avril 1983, jour d’une grande chaîne humaine de plus de vingt kilomètres. Durant l’occupation des lieux pendant dix-neuf ans, de multiples actions non-violentes sont entreprises. La militante Fran De’Ath évoque Greenham Common Women’s Peace Camp comme une expérience puissante : «Elle enseigna à ma génération l’action collective, la protestation comme spectacle et manière de vivre, incroyablement difficile mais parfois joyeuse. Pour moi aujourd’hui encore, l’image de la résistance […] est le souvenir des femmes de Greenham dansant en 1982: des femmes ensorcelantes, désarmées, dansant sur un silo à missile». Cette démarche fait des émules en Australie, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Italie, etc., où des campements similaires sont mis sur pied.
Le 22 mars 1980 a lieu à Amherst, une université du Massachusetts, un meeting intitulé Women and Life on Earth : Ecofeminism in the 1980’s. Le terme « ecofeminist » désignera à partir de cette date une partie des militantes engagées dans les luttes antinucléaires et antimilitaristes transnationales en même temps que la critique théorique qui articule domination des femmes et de la nature par le patriarcat.
À partir des années 90, avec la fin de la guerre froide, l’écoféminisme aux États-Unis, s’enrichit d’une réflexion morale sur l’environnement liée à une tradition de protection de la nature et trouve une place au sein de l’éthique environnementale, mais pas nécessairement dans le féminisme. À cette époque, de nombreuses universitaires tentent de théoriser l’écoféminisme, mais édulcorent souvent sa force politique. Ainsi le mouvement enraciné dans l’action est réduit à une idée et devient l’objet de critiques pour certaines universitaires qui l’accusent d’être « essentialiste » c’est-à-dire de promouvoir l’idée que la femme est par essence plus proche de la nature que l’homme. De vouloir coupler la libération de la femme avec la revalorisation de la nature, l’écoféminisme est accusé de participer au discours de cette thèse où l’association femme/nature est utilisée pour cantonner les femmes aux fonctions du soin, de reproduction et de tâches domestiques qui leur seraient « plus naturelles » et de nier les déterminismes sociaux. C’est pourtant bien par ses actions non-violentes, de réappropriation et de guérison que les écoféministes exigent la réparation culturelle après des siècles de dénigrement. L’écoféminisme retourne cette association négative en un objet de revendications et de luttes politiques qui concernent tout·e à chacun·e.
En France
Le terreau de l’écoféminisme s’avère être beaucoup moins propice en France que dans les pays-anglo-saxons. Pourtant, c’est une poignée de Françaises qui donne un premier élan intellectuel à l’écoféminisme dans les années 70. Anne-Marie de Vilaine, chroniqueuse littéraire au Nouvel Observateur dans les années 1960, s’engage en faveur de l’écologie et se rapproche des Amis de la Terre parisiens à partir des élections municipales de 1977. Elle publie un texte-manifeste La femme et/est l’écologie dans le numéro 43 du mensuel Le Sauvage en juillet 1977 : « La femme et l’écologie… Pourquoi pas la femme est l’écologie? L’organisme féminin et les valeurs féminines pourraient très bien symboliser l’écologie aujourd’hui (3) ». D’après Anne-Marie de Vilaine, c’est l’attention portée à la vie quotidienne qui lie femme et écologie et différencie les écologistes des autres formations politiques. Elle veut privilégier une écologie relationnelle qui doit puiser aux valeurs traditionnelles « féminines ».
À cette période, Xavière Gauthier, chargée de cours à l’université de la Sorbonne, fonde la revue Sorcières l’une des rares revues féministes françaises qui porte attention aux liens entre écologie et féminisme à travers une approche littéraire. Même si, dans les premières années de la revue, aucun texte ne sera directement consacré à l’écologie, il s’agit pour certaines de convoquer des rapports corps/nature comme lien privilégié afin de retrouver une forme de « puissance » féminine. C’est dans ces espaces d’expériences littéraires que s’articulent une théorie féministe de la différence et un intérêt grandissant pour l’environnement.
Enfin cette même époque, la célèbre militante et théoricienne Françoise d’Eaubonne, co-fondatrice du Mouvement de libération des femmes en 1968 au sein duquel elle anime le groupe non-mixte Écologie Féminisme Centre, écrit pour la première fois le mot « éco-féminisme » dans son manifeste « Le Féminisme ou la mort ». Dans ce manifeste, elle développe le lien théorique et politique entre écologie et féminisme. Elle déclare que le féminisme ne peut se contenter de rechercher l’égalité des sexes ou la liberté de l’érotisme quand l’humanité est en crise dans un monde fini. Elle affirme qu’il s’agit désormais d’une question de vie ou de mort généralisée du vivant et que la femme porte un rôle central: « Non pas le matriarcat, certes, ou « le pouvoir par les femmes », mais la destruction du pouvoir par les femmes. Et enfin l’issue du tunnel: la gestion d’un monde à renaître (et non plus à « protéger comme le croient encore les doux écologistes de la première vague.)(4)». L’époque était aussi à la reprise du corps des femmes par les femmes par la gestion de la natalité (contraceptif et droit IVG) et Françoise d’Eaubonne lance un appel international « à la grève de la procréation » dans le but d’échapper à la surpopulation et de préserver les ressources de la planète. Selon elle, les femmes doivent s’emparer de la gestion de la planète en se ré-appropriant leur fécondité et l’exploitation des sols mais également en supprimant le concept de hiérarchie darwiniste en place : « la société mâle et industrielle est arrivée à la destruction de l’environnement, c’est une menace pour la planète. Je suis à fond pour que les hommes perdent le pouvoir. […] Cette société mâle doit devenir une société où les femmes prendront le pouvoir pour le détruire immédiatement (5)». En 1978, elle fonde l’association Écologie-Féminisme et participe également aux activités du commando Ulrike-Meinhof-Puig-Antich en endommageant par deux charges explosives le réacteur en construction de la centrale nucléaire de Fessenheim provoquant le retard de plusieurs mois du chantier. La préconisation de l’usage de la violence pour parvenir à une société plus égalitaire et la multiplication des terrains de lutte avec une position extrêmement radicale, rend impopulaire Françoise d’Eaubonne et opacifie l’écoféminisme en France. Cependant, ces thèses connaissent un accueil plus favorable au Canada, aux États-Unis et en Australie dans les années 1980-1990, où elle est régulièrement invitée en tant que pionnière du mouvement. Aujourd’hui elle est reconnue comme l’une des théoriciennes majeures.