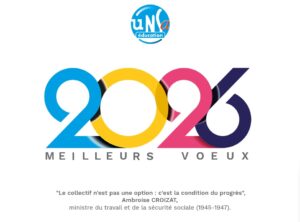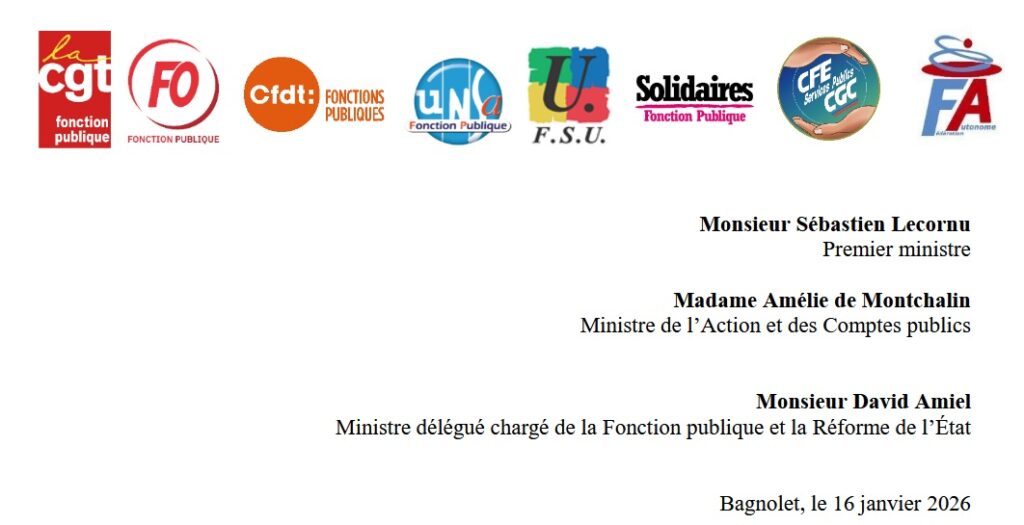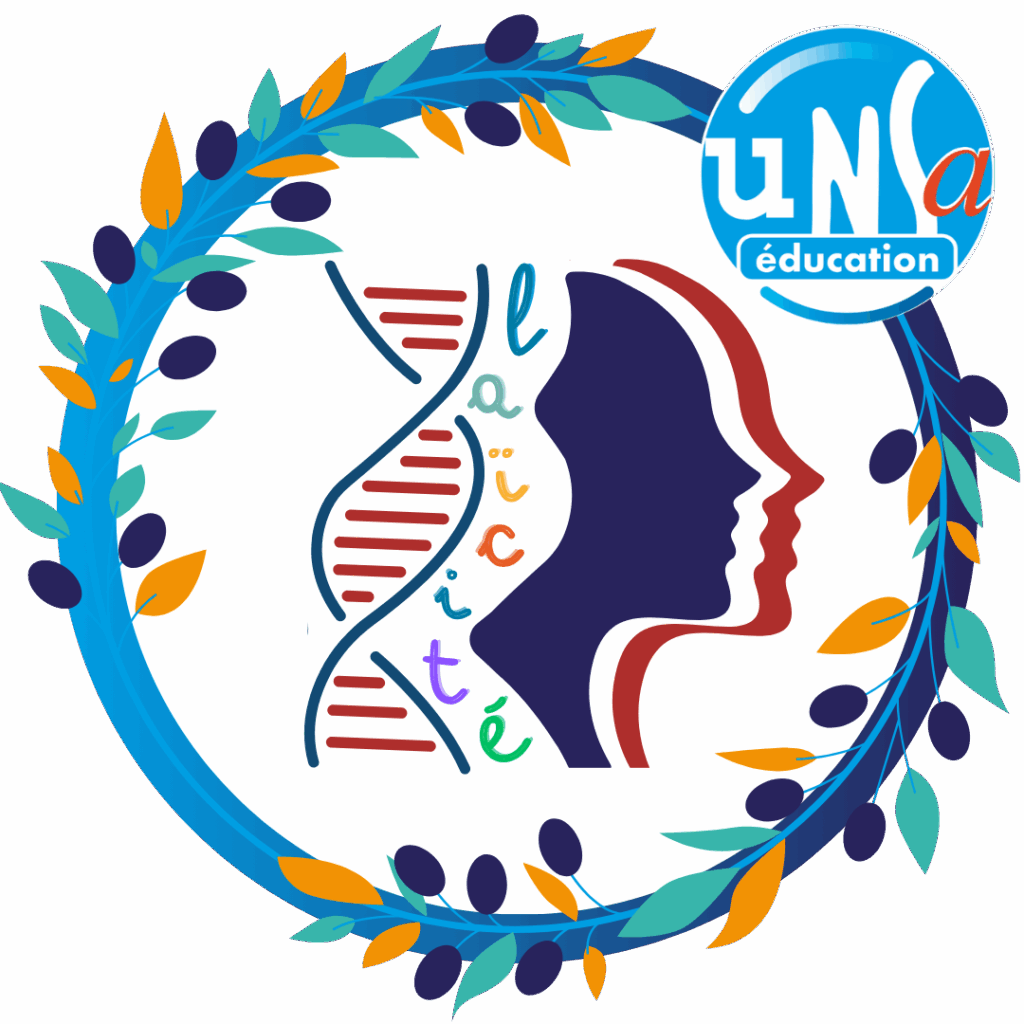« Surtout, ne faites pas comme nous ! » : L’école suédoise en débat

Comment a évolué le système éducatif suédois dans les dernières années ?
Dans les années 80 et 90, il y a eu un mouvement de marchandisation et les politiques éducatives sont passées du niveau national au niveau municipal, à l’initiative des socio-démocrates. La société s’est retrouvée coincée dans un système plus individualisé, sensé provoquer plus de créativité. Il est clair maintenant que nous sommes allés trop vite, et nous devons gérer les conséquences de ce changement.
Les personnels de l’éducation de Suède sont-ils encore fonctionnaires ?
Avec la municipalisation, les personnels de l’enseignement obligatoire et secondaire ont eu l’impression de passer du statut d’expert gouvernemental au statut d’employés municipaux. Et cette situation s’est retrouvée dans beaucoup de professions féminisées. Avec en parallèle une évolution importante avec le développement et la concurrence d’écoles « indépendantes ». Et les personnels ont eu une impression de dévalorisation. Cette dévalorisation peut se retrouver à l’échelle européenne mais pour nous elle venait de cette transformation. De la marchandisation d’une école où les écoles se disputent les inscriptions des enfants et doivent prouver qu’elles prennent mieux en compte leurs besoins individuels.
Comment se sont développés les établissements privés indépendants ?
Au début, quand la loi est passée, on pensait que des pédagogies alternatives se développeraient, mais en fait ce sont des chaînes à but lucratif qui ont pris le marché en profitant d’aides fiscales. La loi de libéralisation du système éducatif, c’était le fait de donner des « chèques » aux familles pour choisir de financer l’école de leur choix, publique ou privée, mais ce « chèque » n’est pas le même dans toutes les villes, dépendant de leur taille. Ce chèque est le même que l’école soit publique ou privée alors que les écoles privées ne sont pas sujettes aux mêmes obligations.
Comment se comportent les familles par rapport à cette école privée ?
Les écoles indépendantes (privées) s’installent dans les quartiers riches où il y a moins d’élèves en difficulté. Les familles s’inscrivent dès la naissance pour être sûres d’y entrer. Les écoles veulent faire une marge avec les élèves, donc les effectifs par classe sont très importants. Le but est de baisser les coûts à tout prix, y compris dans les coûts d’enseignement. Ces élèves sont ceux qui sont les plus aidés à la maison donc ils s’en sortent bien. 17 % des élèves suédois vont dans les écoles privées mais dans les grandes villes, Stockholm, Göteborg, on peut aller jusqu’à 40 % de privé dans le secondaire. Alors qu’il n’y a pas d’école privée dans certaines villes !
La municipalisation du système éducatif, était-ce une bonne idée ?
Je dirais un grand « non » ! Par toutes les expériences menées, nous nous sommes trompés de multiples manières. Pas de « standards » pour les enseignants, pour la formation des enseignants, pour le temps de préparation, et comme les municipalités manquent d’argent, il est très dur de gérer la question de la charge de travail des personnels. D’après l’OCDE, la dépense éducative de la Suède est importante mais elle ne va pas au bon endroit. Nous voulons re-centraliser l’école suédoise, avoir des standards nationaux. La situation est inacceptable quand les personnels sont plus payés dans les grandes villes que dans les petites villes. Les personnels formés vont dans les grandes villes et les écoles du monde rural ont beaucoup de mal à attirer des personnels qualifiés. Dans beaucoup d’écoles du monde rural, la majorité des enseignants ne sont pas qualifiés.
Ce modèle d’école privée a pourtant le vent en poupe, même dans le débat politique français, quels sont les arguments contre ?
Alors on dira aux gens, « ne le faites pas, on l’a fait, ce n’est pas bon pour vous », la marchandisation, la commercialisation, la décentralisation, ont eu des effets négatifs. La décentralisation aurait pu avoir du bon mais l’expérience n’a pas été concluante. Les municipalités tiennent à garder la politique éducative parce que les partis au pouvoir, socio-démocrates et modérés, sont aussi ceux qui tiennent les collectivités territoriales. Et parce qu’elles ont obtenu des moyens importants dans la décentralisation, avec un financement orienté vers les objectifs, pas sur les moyens pour les assurer. Si vous en parlez aux collègues, dites-leur que cette évolution sera mauvaise pour leur charge de travail dans un système où on ne parle que d’efficience financière. Vu qu’on ne peut pas jouer sur les coûts de l’établissement on joue sur le personnel, pour donner plus de travail. On utilise même l’intelligence artificielle pour faire plus de marge. L’efficacité ça peut marcher dans la production de biens peut-être, mais pas dans un travail humain puisqu’on épuise la ressource humaine..qui du coup sont moins au service des élèves et des apprentissages du fait de cet épuisement.
Comment est-ce possible de travailler pour un syndicat dans ce contexte ?
C’est plus difficile dans le secteur privé que dans le secteur public. Dans le public, nous syndiquons 90 % des enseignants qualifiés. Dans le système municipal, nous avons des moyens syndicaux pour les militants, plus dans les grandes villes que dans les petites d’ailleurs. Il n’y a pas de moyens syndicaux, pas de lieux de négociation dans les écoles indépendantes. Les deux grands syndicats de l’éducation ont fusionné en Suède, nous avons juste un autre syndicat dans le milieu universitaire. Le syndicat est très organisé à l’échelle municipale, car c’est là que la négociation importante se passe, c’est d’autant plus difficile d’assurer une égalité des droits et des conditions de travail pour les personnels, vu que les collectivités veulent garder leur marge de manœuvre. Notre effort porte donc sur la création d’espaces de négociation nationaux. Les conventions collectives sont négociées régulièrement, tous les 2 à 4 ans. Les actions syndicales revendicatives ne peuvent être menées que sur des sujets nationaux de négociation ce qui complique le rapport de force.
Les salaires et les conditions de travail sont-ils régulés nationalement ?
Seule l’augmentation moyenne des salaires est négociée à l’échelle nationale. Mais ensuite, les salaires sont fixés individuellement au recrutement et le chef d’établissement doit juste assurer que l’augmentation obtenue lors de la dernière négociation, 6,4 %, est garantie comme moyenne pour l’ensemble des personnels. Si la moyenne n’est pas assurée, nous pouvons engager un recours judiciaire.
Quelles sont vos principales revendications en ce moment ?
Obtenir des standards nationaux pour encadrer le métier enseignant, pour réduire la charge de travail des personnels, pour réduire notamment les tâches administratives. En général le temps d’enseignement a un peu baissé mais les autres tâches ont beaucoup augmenté. Au détriment de la remédiation et de l’aide aux élèves. Pourtant les enseignants veulent continuer à le faire. Nous aimerions obtenir que ces tâches complémentaires soient régulées avec un ratio, par exemple pour une heure d’enseignement, 0,2 heure pour la préparation. Les personnels travaillent 45 heures par semaine car leur temps de vacances est pris en compte dans le calcul du temps hebdomadaire de 40 heures. 35 heures sont décidées par l’employeur et 10 heures peuvent être faites à la maison comme les personnels l’entendent. Nous aimerions que ce temps de préparation puisse être organisé librement par les enseignants. De même pour le remplacement des autres collègues qui n’est pas encadré dans tous les établissements. Les autres tâches complémentaires sont de documenter ce qu’on fait avec les élèves, pour leur bien-être, les résultats, les besoins individuels, nous aimerions moins de pression sur ce travail de type « new management system ». Les enseignants qui tutorent des collègues ou qui sont professeurs principaux d’une classe ou d’une partie de la classe ne sont pas rémunérés pour ces missions, comme en France.
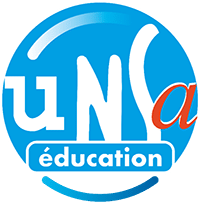
 Nos dossiers
Nos dossiers