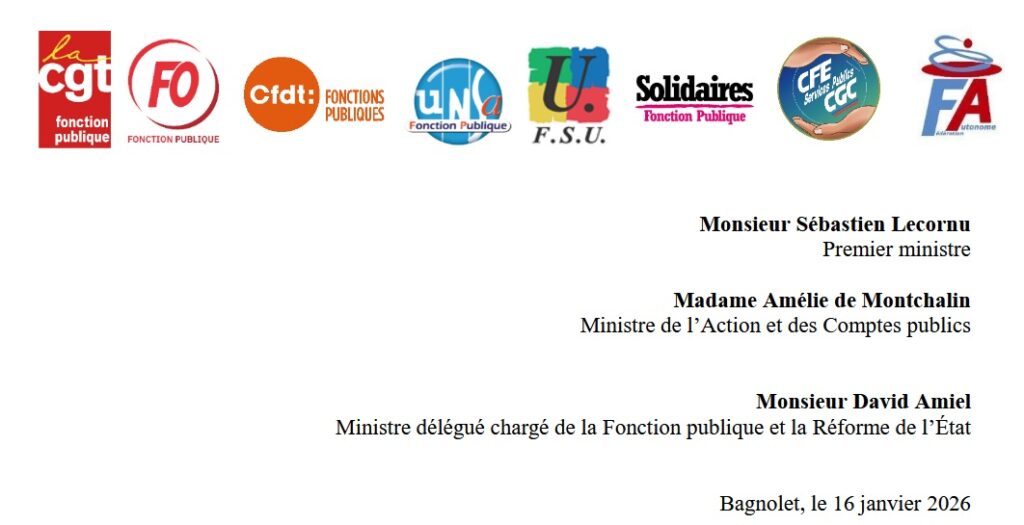Santé et climat : entre prospective et procrastination
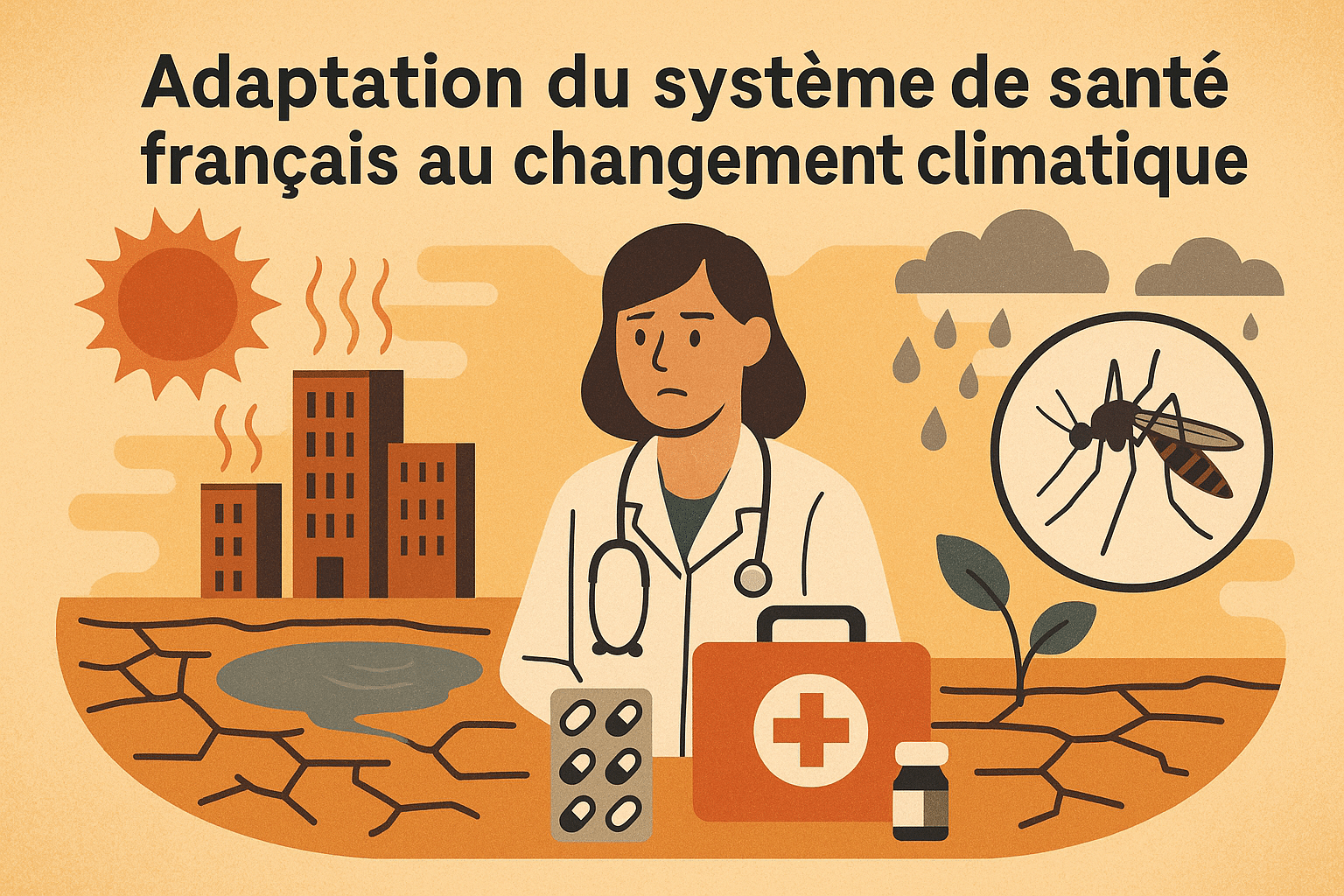
Le troisième Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC-3) consacre sa mesure 29 à l’adaptation du système de santé face aux impacts croissants du dérèglement climatique. Ce volet se déploie autour de deux axes principaux.
D’abord, une étude prospective nationale est prévue pour évaluer les conséquences du changement climatique sur la santé et proposer des pistes d’adaptation à court, moyen et long termes. Elle devra aborder la formation des professionnels de santé, l’organisation de l’offre de soins, la sécurisation des chaînes d’approvisionnement (énergie, eau, médicaments), et l’analyse de la vulnérabilité des bâtiments hospitaliers et médico-sociaux.
Ensuite, la mesure prévoit une planification décentralisée, où les Agences Régionales de Santé (ARS) intégreront ces enjeux dans leurs schémas de santé, avec des diagnostics locaux et la formation des personnels aux risques environnementaux.
Mais derrière cet exposé ordonné se cache une faiblesse structurelle : l’absence quasi totale de mesures concrètes immédiatement mobilisables. Le cœur de la mesure repose sur des études, des diagnostics, des inventaires, des indicateurs. On ne trouve aucun engagement clair sur des actions de transformation, ni de chantiers lancés, ni de budget alloué. Le vocabulaire employé — « cahier des charges », « chiffrage en cours », « parangonnage » — trahit une logique de gestion administrative plus que de mobilisation face à un péril sanitaire majeur.
Il est par ailleurs révélateur que la stratégie nationale de santé, censée donner les grandes orientations du pays en matière de politique sanitaire, soit toujours en cours de révision (depuis 2022), sans date de publication clairement annoncée. Cette absence de cadre actualisé affaiblit d’autant plus la portée de la mesure 29, qui devrait pourtant s’y adosser pour être pleinement cohérente et opérationnelle. Dans le même temps, le PNACC-3 lui-même a été publié avec près d’un an de retard, alors même que les effets du changement climatique s’accélèrent. Ce double décalage – à la fois stratégique et temporel – alimente l’impression d’un pilotage à vue, où les plans se succèdent sans véritable articulation ni volonté d’entrer dans une logique d’urgence. Le résultat est un empilement de réflexions institutionnelles qui peinent à se traduire en actions tangibles sur le terrain.
En refusant de prendre des décisions opérationnelles, cette mesure illustre un dangereux décalage entre l’ampleur de la crise climatique et la lenteur de la réponse institutionnelle. On parle ici d’un monde à +3°C voire +4°C : une perspective dans laquelle les hôpitaux deviendront des zones de tension permanente, les maladies infectieuses se multiplieront, et les infrastructures risquent la rupture. Face à cette urgence, repousser les actions à « après l’étude », à « dans six mois », à « l’intégration dans les plans régionaux » sonne comme une abdication politique.
En somme, la mesure 29 propose une réflexion quand il faudrait une mobilisation, une planification quand il faudrait une transformation, et un calendrier dilué quand il faudrait des actes immédiats. Le hiatus entre l’urgence climatique et la temporisation institutionnelle est frappant. À trop attendre pour agir, c’est la santé publique elle-même que l’on met en danger. Et ce sont les plus précaires qui en pâtiront les premiers.
Certains territoires concentrent des populations fragiles dans des zones paupérisées. L’UNSA Éducation affirme la nécessité d’y mettre des moyens renforcés. Les structures éducatives et de formation de ces territoires doivent continuer d’être reconnues comme prioritaires par les politiques interministérielles pour garantir les moyens qui permettent l’application des politiques de santé et l’accès aux droits. L’UNSA Éducation milite pour le développement de la promotion de la santé comme processus permettant à chacun de contrôler sa propre santé et d’améliorer celle-ci. Cette démarche inclut aussi l’amélioration des conditions de vie, des facteurs sociaux, économiques et environnementaux.
Pour aller plus loin sur le même sujet :
La formation dans le monde agricole : un levier face au changement climatique
L’IA au service de l’adaptation climatique, mirage ou bonne idée ?
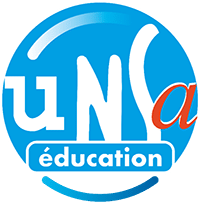
 Analyses et décryptages
Analyses et décryptages