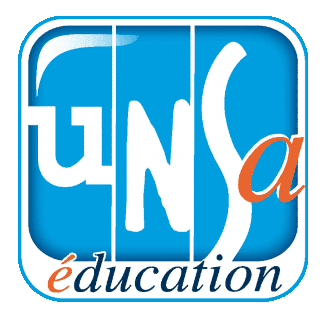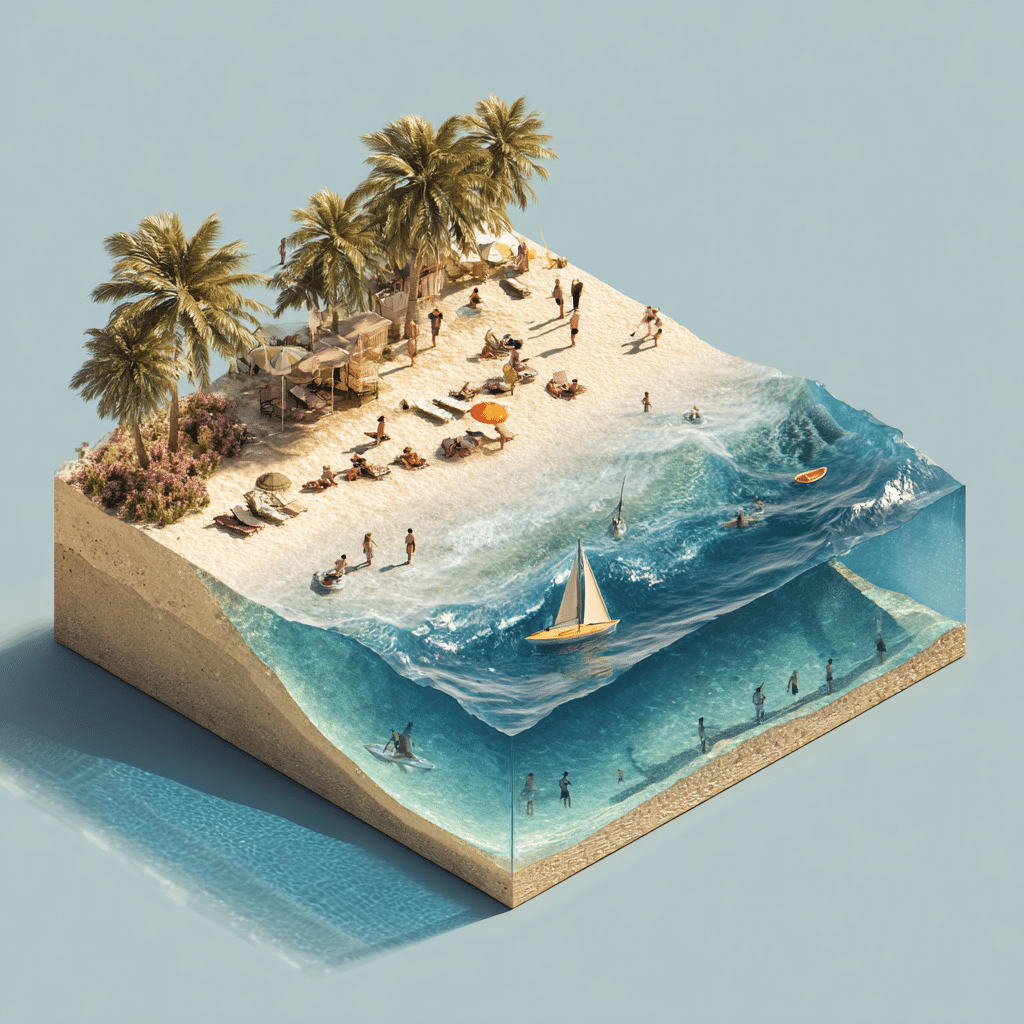10 ans après, nous sommes Charlie.

La liberté d’expression, « un droit fondamental »
A l’origine, ce sont de simples caricatures publiées par Charlie Hebdo qui avaient été instrumentalisées et brandies comme prétexte à cette folie meurtrière. Comme pour l’odieux assassinat de Samuel Paty, c’est l’esprit critique, le droit au blasphème et la liberté d’expression qui avaient été frontalement attaqués.
Dans son édition spéciale du 7 janvier 2025, « Charlie » publie les résultats d’une étude récente de l’institut IFOP pour la fondation Jean Jaurès indiquant que les Français estiment pour 76 % d’entre eux que la liberté d’expression est un droit fondamental, conformément aux articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme.
Bien entendu, la liberté de caricaturer en fait partie. D’après le même sondage, près de 2/3 des Français se disent favorables « au droit de critiquer de manière outrageante une croyance, un symbole ou un dogme religieux ». D’ailleurs, notre République laïque ne reconnaît pas de délit de blasphème. Il est de notre devoir de continuer à perpétuer cet esprit des caricaturistes qui épinglent avec humour et justesse les travers de nos sociétés.
La laïcité, rempart au fanatisme religieux
Malgré les tensions sous-jacentes entre la liberté d’expression et le respect des croyances religieuses alimentées par certains, il n’y a pourtant aucune ambiguïté. La laïcité consacre de manière claire et équilibrée une double exigence : celle de la garantie de la liberté de conscience et de culte, mais également la neutralité de l’État, imposant ainsi l’égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou de conviction. La laïcité garantit, par essence, aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d’expression de leurs croyances ou de leurs convictions.
L’école se trouve ainsi en première ligne pour faire vivre ce principe de laïcité à travers, notamment, l’Enseignement Moral et Civique et par la valeur de l’exemple offert dans cette micro-société qu’est un établissement scolaire. Les échanges peuvent avoir lieu dans un cadre sécurisé et bienveillant, permettant au débat de confronter les points de vue. La formation et l’information sont donc indispensables pour tordre le cou à certaines idées reçues et lever d’éventuelles incompréhensions.
L’équilibre de la liberté d’expression : le respect et la loi
La liberté d’expression n’est évidemment pas absolue. Elle est encadrée par la loi. La loi de séparation des Églises et de l’État de 1905, dont on célèbrera les 120 ans cette année, s’est d’ailleurs effectuée sous la houlette d’Aristide Briand dans un esprit de concorde. Cette stricte séparation se fonde, en effet, sur l’union dans le respect de chacun pour accomplir son œuvre émancipatrice.
L’instrumentalisation des caricatures publiées par Charlie visaient à induire l’idée sournoise que la critique d’une religion relevait in fine de la discrimination des croyants. Pourtant, là aussi, la loi est claire. Le traitement inéquitable d’un individu en raison de son origine ou de sa religion constitue une discrimination reconnue par la loi dans son article 225-1. Elle donne lieu à des sanctions clairement établies. De fait, la laïcité, en permettant la liberté d’expression cherche au contraire à rassembler pour permettre de faire société autour des valeurs républicaines et non à exclure.
Agiter les peurs comme le font les terroristes, les fanatiques religieux et les obscurantistes de tous bords procède de la logique de manipulation des esprits. L’éducation à l’esprit critique reste le meilleur moyen de former des individus libres capables d’éviter le piège tendu par les ennemis de la liberté.
Les signes d’une fragmentation de la société
Les jours qui ont suivi l’attentat du 7 janvier 2015 ont été marqués par une immense vague de solidarité. Le 11 janvier 2015, ce sont plus de 4 millions de personnes qui ont défilé dans les rues de Paris et dans d’autres villes françaises pour exprimer leur soutien à la liberté d’expression et leur indignation face à la violence. Au-delà des frontières, ce mouvement sans précédent a rassemblé des citoyens du monde entier autour de la défense de la liberté d’expression.
Et même si, dix ans plus tard, l’émotion et le souvenir restent intacts, force est de constater que l’unité a eu du mal à survivre à l’épreuve du temps, signe incontestable du morcellement et de la fracturation de notre société. Certes, des commémorations sont organisées pour honorer ceux qui ont perdu la vie ce jour-là et pour rappeler notre attachement à la liberté d’expression mais dans un contexte devenu complexe où la désinformation et la censure sont omniprésentes, le défi s’avère difficile à relever.
Au fond, ce drame a testé notre capacité de résilience et a mis à l’épreuve tout un peuple quant à son lien à la laïcité, à la liberté d’expression et à la cohésion sociale. La lutte pour ces principes fondamentaux et ces valeurs cardinales reste plus que jamais d’actualité. Notre République abîmée a besoin de rassemblement, d’union et de fraternité.
Fidèle à ses valeurs et liée de manière consubstantielle à la laïcité, l’UNSA Éducation continuera donc inlassablement à défendre le droit de critiquer, de questionner et de débattre, tout en honorant la mémoire des porteurs de liberté.