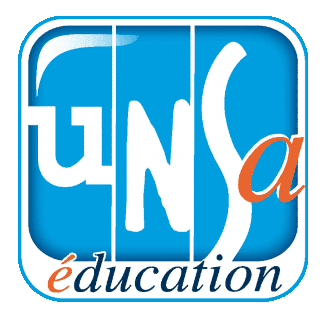.png)
Les mauvais résultats du système éducatif français auraient tendance à nous faire oublier que la question de la réussite de tous les enfants se pose dans de nombreux pays. Souvent les mêmes constats, conduisent aux mêmes prises de conscience et aux mêmes préconisations. Ainsi en est-il de l’étude belge conduite par Sandrine GROSJEAN pour le mouvement socio-pédagogique CGE (ChanGement pour l’Égalité) et intitulé « Apprendre en maternelle Dépasser la bienveillance ».
« Des inégalités en maternelles ? Oui, elles existent. Et qu’en fait-on ?
Il est très rare que les enseignants du maternel se voient comme des acteurs politiques. Pourtant, l’école a une triple fonction sociale : instruire, socialiser et sélectionner.
On peut supposer que tous les enseignants se reconnaissent dans le premier objectif qu’on pourrait reformuler en disant : faire entrer tous les jeunes dans la culture de l’écrit et de l’abstrait, transmettre un savoir qui aille au-delà du savoir-faire.
Pour le deuxième, la socialisation, il y a déjà plus de nuances. Autant les enseignants du maternel voire du primaire sont très conscients de cette mission et la prennent en charge, autant au secondaire, bon nombre de professeurs dissocient ces fonctions en disant « moi je suis là pour enseigner, pas pour éduquer ».
Pour le troisième objectif, la sélection, la tendance s’inverse. Les enseignants du fondamental ne s’y reconnaissent pas, là où certains enseignants du secondaire assument partiellement au moins ce rôle.
Pourtant, notre système scolaire agit à ces trois niveaux et donc tous les agents du système contribuent plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement aux différents objectifs.»
Ainsi débute cette étude qui met en évidence des « pratiques de classe qui agissent sur le passage de l’enfant à l’élève, au-delà de la bienveillance » des enseignants. L’analyse de sept séquences trouvées sur la toile montrent « que certaines pratiques favorisent l’entrée dans les apprentissages scolaires, d’autres moins ». Tout en rappelant que « les apprentissages en maternelles servent de fondation à toute la scolarité », l’auteure affirme qu’il est « indispensable que les adultes » qui accompagnent les enfants « soient conscients des passages nécessaires » qui leur permettent de devenir « des élèves apprenants. Faute de quoi, les enfants dont les familles sont éloignées de la culture scolaire risquent de passer à côté des attitudes indispensables pour apprendre, creuset des inégalités scolaires. »
Comme dans le cas de l’École française, cette étude met en lumière les dérives de la sélection qui conduisent à ce que ce soient « les enfants ayant les indices socioéconomiques les plus faibles qui sont le plus maintenus en maternelle et orientés vers l’enseignement spécial » et participant ainsi à « une reproduction des inégalités de génération en génération ».
Lutter contre cette dérive demande d’être conscient des choix effectués, mais aussi –dans un souci de prévention- « de mettre en œuvre des stratégies qui misent sur le maillon le plus faible, les enfants les plus éloignés de la culture scolaire ». Le constat révèle alors que, dans le cas d’intégration d’enfant porteur de handicaps ou dans la prise en compte des difficultés d’apprentissage, « les appuis et les relais se créent et tous les élèves en profitent ».
L’étude qui tente « de mettre en lumière des pratiques de classe qui permettent de lutter contre les inégalités ou qui inconsciemment les renforcent », conclut donc que « l’enseignant est un acteur politique qui a une réelle possibilité d’action sociale, seulement il n’en est que rarement conscient, car il a peu de connaissances sur les impacts de ces actions dans la reproduction des inégalités ».
Des éléments essentiels à mettre au cœur de la formation de tous les enseignants et acteurs de l’Éducation… et pas seulement en Belgique !
L’Unsa Education, très attachée à ce que l’égalité entre les hommes et les femmes soit réelle, vous recommande la lecture de l’édition 2017 de la brochure des chiffres-clés Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes – l’Essentiel.*
Une nouvelle édition, composée d’infographies claires, qui révèle les inégalités femme-homme à partir de données statistiques actualisées et qui passe au crible un ensemble de domaines tels que l’éducation, la formation, l’emploi, la précarité́, la santé, la culture, le sport ou encore les violences faites aux femmes.
Rien de nouveau à l’horizon?
Pourtant si !
Car ces données chiffrées permettent de mettre en exergue des inégalités existantes et persistantes que nous devinons tous au quotidien sans réellement les percevoir, reflets d’un sexisme omniprésent dans la sphère professionnelle ou privée.
Cibler ces inégalités et prendre conscience de leurs manifestations est sans nul doute, une des clés pour lutter efficacement contre et amener à la mobilisation de tous et toutes pour y remédier.
*Réalisée chaque année par le Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes (SDFE) de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Pour lutter contre les inégalités entre élèves et combattre la discrimination, le conseil général de Seine Saint Denis lance le 6 novembre une plate-forme dédiée aux stages des élèves de 3ème scolarisés dans les collèges du département.
Le stage de 3ème est l’occasion pour les élèves de découvrir le monde du travail. La confrontation avec celui-ci et ses difficultés débutent dès la recherche de stage.
En effet, il est difficile pour des collégiens qui ne disposent pas de réseau professionnel ou de contact dans le monde du travail de trouver un stage de leur choix.
L’objectif est de mettre en relation futurs stagiaires, parents, professeurs avec les organismes entreprises, associations, artisans, collectivités territoriales souhaitant les accueillir le temps d’une semaine d’observation.
Le site «Mon stage de 3ème» est destiné à ceux qui ne parviennent pas à trouver de stage. Élaboré avec l’Éducation Nationale, il permet aux élèves de postuler à une offre anonymement. Les noms et adresses sont divulgués au moment de conclure.
Espérons que cette initiative permette aux élèves et aux entreprises de créer le lien social et économique et réduise les inégalités qui touchent leurs aînés et qu’elle ne connaisse pas le même sort que les CV anonymes prévus dans la loi de 2006 (qui n’ont pas été appliqués suite à l’échec de l’expérimentation) .
L’Observatoire des inégalités organise, entre le 1er octobre 2013 et le 14 février 2014, un concours « vidéo » sur les inégalités et les discriminations ouvert à tous les jeunes de 11 à 21 ans avec pour mot d’ordre :
« Partez en campagne contre les idées reçues qui véhiculent les inégalités et les discriminations ! ».
Pour en savoir plus voir le site de l’observatoire des inégalités :
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=espacejeune_article&id_article=1837id_rubrique=220
L ’UNSA Éducation réaffirme que l’éducation à l’orientation est un enjeu majeur et doit être un levier pour agir contre les inégalités filles – garçons.
Une récente note de la DEPP sur les parcours des élèves de terminale, rappelle la sous représentation des filles dans certains enseignements :
«La sous-représentation des filles dans tous les enseignements scientifiques sauf en SVT, constatée pour les premières générales de la rentrée 2019, se retrouve pour les terminales générales à la rentrée 2020»
Lutter contre les stéréotypes
Il est indispensable de mener des programmes spécifiques pour éviter une orientation vers des professions stéréotypées. On ne doit pas se satisfaire de la composition de lycées industriels de «garçons» ou de classes de bac pro ASSP (accompagnement, soins et services à la personne) exclusivement féminines. Il n’y a pas de fatalité : une éducation sans stéréotypes de genre est possible. L’ensemble des professionnel.les doit être mobilisé pour encourager les filles à s’orienter vers les enseignements et filières scientifiques pour leur permettre de se diriger vers les métiers de chercheur.e, ingénieur.e, électricien.ne ou encore informaticien.ne. L’ensemble des acteurs et actrices de l’éducation doivent accompagner les élèves pour une meilleure connaissance d’’eux mêmes. C’est un point essentiel pour déconstruire les stéréotypes de genre.
Lutter contre l’auto censure
La question de l’auto censure doit impérativement être pris en compte dans l’orientation scolaire des filles. Il est indispensable de prendre en compte la dimension psychologique de l’orientation afin qu’elle relève d’un choix positif. Pour se faire, l’éducation à l’orientation doit commencer tôt pour permettre une ouverture et une affirmation des potentialités de chacune et chacun. Nous devons encourager les jeunes filles à avoir plus d’ambition et à oser au regard de leurs résultats scolaires.
À l’occasion du 8 mars, le ministre a annoncé la création d’un groupe de travail national sur l’égalité filles-garçons dans les choix d’orientation au lycée général et technologique, dans le cadre du comité de suivi de la réforme du lycée. Ce comité aura pour but de « changer le regard sur les disciplines, pour une pleine égalité des possibles et une véritable émancipation face aux préjugés et aux déterminismes ». Espérons qu’il ne s’agisse pas d’un effet d’annonces. Ce groupe de travail devra permettre de réelles avancées.
Pour l’Unsa Education, nous devons agir dès le plus jeune âge. Pour lutter contre les stéréotypes de genre, nous devons transmettre une véritable éducation sans stéréotypes. Nous pouvons faire évoluer les mentalités et agir sur l’orientation scolaire des jeunes filles.
La CPED (Conférence Permanente des chargé·es de mission Égalité, Diversité) a rédigé un courrier le 18 mai 2020 à l’attention des présidents et présidentes d’universités et des directeur·rices des grandes écoles.
Celui-ci alerte sur le risque d’inégalités de genre dans les recrutements et les comités de sélection suite à la crise sanitaire.
Pour l’UNSA Éducation, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est une priorité absolue.
Nous relayons donc ce communiqué qui en plus de mettre en garde, donne des pistes de réflexions dans la prévention de la lutte contre les effets du sexisme au sein des universités et grandes écoles.
Mais pour quelles raisons cette crise aurait-elle impacté le recrutement des femmes à l’université et les chercheuses ?
La période de confinement, loin de favoriser le partage des tâches domestiques, comme on aurait pu l’imaginer, a au contraire renforcé les inégalités et les femmes ont dû faire face à un surcroit de travail domestique : lire notre article à ce sujet «Confinement au quotidien : qui passe l’aspirateur ? »
Ainsi, le confinement n’a pas permis aux femmes de se préparer au mieux au recrutement du supérieur qui demande énormément de travail dans la gestion du dossier scientifique et de l’audition parce qu’elles ont dû assumer une plus grande part des responsabilités familiales.
De même, les revues scientifiques ont noté une baisse des propositions de publications faites par les femmes. En effet, les chercheuses ont été moins disponibles pour écrire des articles scientifiques ou poursuivre leurs projets, alors que dans le même temps, au contraire, les hommes en ont proposés davantage. *
Notre fédération milite pour une véritable égalité entre les femmes et les hommes, en tant que professionnel·les de l’Éducation.
Or, il est fondamental que nous soyons tous et toutes vigilant.es afin que cette crise sanitaire ne creuse pas davantage les inégalités entre les femmes et les hommes, qui plus est, dans un domaine, celui de la recherche, où il persiste encore beaucoup trop d’inégalités.
Il ne tient qu’à nous que ce monde d’après soit bien celui de l’égalité et cela à tous les niveaux d’enseignement.
*Who is doing new research in the time of COVID-19? Not the female economists
Pour complèter :
Lettre de la CPED » Crise sanitaire, inégalités femmes-hommes et comités de sélection : notre lettre aux président·es et directeur·ices d’établissements «
Le ministère vient d’annoncer un renforcement de ces mesures qui concerne les écoles des territoires défavorisés. Ces deux mesures ne sont pas suffisantes. L’UNSA Éducation revendique la mise en place d’une véritable politique sociale et de santé au bénéfice des élèves ainsi que l’accès à la restauration scolaire pour tous.
Le dispositif
– En 2019, 110 000 élèves de maternelle et de primaire ont bénéficié des petits déjeuners dans les écoles de l’éducation prioritaire. Pour 2020, l’objectif du ministère est de permettre à 200 000 élèves de prendre un petit déjeuner gratuit pour leur permettre de bien apprendre.
– Concernant la cantine à 1 euro, 8000 élèves de 150 communes rurales ont été concernés. Le dispositif sera doté de 5 millions d’euros et élargi aux écoles maternelles en 2020 pour mieux prendre en compte les besoins des communes rurales. Cette mesure «cantine à 1euro» est en réalité une aide de l’État en faveur des 4 000 communes et intercommunalités rurales de moins de 10 000 habitants qui perçoivent la dotation de solidarité rurale. L’objectif est la mise en place d’une tarification sociale des repas de cantine scolaire. La cantine à 1€ c’est donc le financement d’une part des repas servis par la cantine si la commune volontaire met en place une tarification progressive composée d’à minima trois tranches, la tranche la plus basse étant à maximum 1€ par repas et par enfant. Cette aide s’adresse à toute petite commune rurale volontaire pour mettre en place cette tarification sociale. Cela vise à répondre à un besoin des familles précaires qui vivent en ruralité mais ne peuvent pas toujours payer la cantine pour leur enfant. D’après une enquête menée par l’IFOP en janvier 2020, 42% des communes ne pratiquent pas de tarifs sociaux pour les cantines scolaires. Les petites communes rurales sont particulièrement concernées du fait de leur manque de moyens pour financer la mise en place de tarifs sociaux.
Notre analyse
Le gouvernement inscrit ces mesures dans le cadre de sa stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Pour l’Unsa Éducation, ces éléments prennent en compte un bien être fondamental des enfants et des jeunes : être nourri, une condition préalable pour apprendre. Cependant, il nous semble indispensable d’aller plus loin.
L’école française est toujours aussi inégalitaire. Les résultats de l’enquête PISA nous le rappellent chaque année. Notre système éducatif ne peut pas se contenter de ces mesures pour lutter contre les inégalités et la pauvreté. Nous pensons qu’il faut impliquer l’ensemble des acteurs. Nos assistantes sociales sont formées pour détecter les situations de pauvreté. Ce n’est pas le cas des autres personnels qui devraient être également formés à détecter la grande pauvreté. La formation initiale et continue doit impérativement s’emparer de cette question pour permettre aux personnels d’apprendre à réagir de manière professionnelle. Chaque situation est différente et surtout les élèves apprennent à cacher les signes de pauvreté. Notre école se doit de porter un regard attentif et bienveillant et avoir une prise en charge efficace. Pour se faire, nous pensons que le budget des fonds sociaux est un levier pour construire des solutions. Le gouvernement a choisit fin 2019 de baisser le montant de l’enveloppe dédié. Nous le regrettons et défendons l’élargissement des critères des fonds sociaux et sa mise en place pour le 1er degré. En effet, dans les territoires, ces aides permettent aux équipes d’agir et de répondre au plus près des besoins, en complément des bourses. Concernant les bourses, nous défendons une révision significative des barèmes et une revalorisation de leur montant.
Enfin, rappelons qu’en 2016, Jean Paul Delahaye dans un rapport sur la «Grande pauvreté et la réussite scolaire» préconisait de «rendre accessible la restauration scolaire comme un droit sans condition». En 2020, nous n’en sommes toujours pas là….
La France fait partie des pays les plus inégalitaires, c’est ce que nous disent les résultats de l’enquête PISA 2018 . Pour l’Unsa Éducation, il est possible et indispensable de lutter contre ces inégalités.
L’enquête pointe plusieurs éléments :
– « la France demeure un pays dans lequel les ressources matérielles et culturelles comptent le plus dans la performance des élèves ». Elle fait ainsi « partie des pays les plus inégalitaires, avec le Luxembourg, Israël ou la Hongrie ». Les élèves défavorisés ont cinq fois plus de chances d’avoir des difficultés en compréhension de l’écrit que les élèves les plus favorisés.
– On constate aussi un écart de 107 points entre les élèves issus d’un milieu favorisé et ceux issus d’un milieu défavorisé en compréhension de l’écrit contre 89 points pour la moyenne des pays de l’OCDE. L’écart, qui était de 110 en France en 2009, n’a pas baissé de manière significative.
– De nombreux élèves français, en particulier ceux issus de milieu défavorisé, ont des ambitions moins élevées que ce à quoi on pourrait s’attendre compte tenu de leurs résultats scolaires. En France, un élève défavorisé sur cinq ayant de bons résultats ne prévoit pas de faire des études supérieures – alors que cette proportion est quasi nulle parmi les élèves favorisés.
L’Unsa Éducation revendique que les moyens de faire réussir toutes et tous soient donnés à l’ensemble des professionnels de l’ éducation.
Les enseignants agissent au quotidien pour faire progresser les élèves les plus en difficulté. Les chefs d’établissements mettent en place des dispositifs d’aide et agissent pour améliorer le climat scolaire de leurs établissements, un levier indispensable pour favoriser la réussite de tous. Les assistantes sociales accompagnent les élèves et leur famille pour améliorer leur condition de vie et d’apprentissage. En somme, l’ensemble des acteurs éducatifs,y compris en dehors de l’École, se mobilise pour combattre ces inégalités, qui ne sont pas une fatalité. Avec des personnels reconnus, mieux formés, en nombre suffisant et avec des conditions d’enseignements plus favorables dans les territoires les plus en difficulté, nous pourrions mieux combattre ces inégalités.
Enfin, des dispositifs et plus largement certaines politiques éducatives ont su ou pas démontrer leur efficacité. Il est nécessaire d’évaluer puis de stabiliser les politiques éducatives qui doivent être centrées sur les élèves en difficulté sociale et scolaire. Donnons nous le temps et surtout les moyens d’y parvenir. L’Unsa Éducation agira à tous les niveaux dans ce sens.
Retrouvez les autres articles sur PISA 2018
– les infos essentielles http://www.unsa-education.com/PISA-La-France-n-avance-pas
– notre analyse https://questionsdeduc.wordpress.com/2019/12/04/pisa-2018-livre-analyse-et-maintenant/
Un tiers des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté et ces familles sont composées à 85 % de femmes qui élèvent seules presque 3 millions d’enfants.
L’UNSA Éducation a participé le 8 octobre 2019 au colloque « Femmes et précarité » du Laboratoire de l’Égalité en partenariat avec la Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes et le Service des droits des femmes et de l’égalité.
3 tables rondes y ont abordé de front un sujet qui nous concerne toutes et tous. Car derrière « le » précaire d’aujourd’hui se cache avant tout cette femme jeune, urbaine, cheffe de famille monoparentale et qui ne parvient pas à s’insérer durablement sur le marché du travail.
Or, lors de ce rendez-vous de l’égalité, l’une des réponses pour résoudre ce problème est apparue dans l’Éducation à l’égalité.
En effet, les choix d’orientation scolaire se font encore trop souvent au prisme du genre : 83% des élèves des écoles paramédicales et sociales sont des filles, 93% des élèves de STI (Sciences et Techniques Industrielles) sont des garçons.
Ces choix ne seraient pas si incommodants si les filières choisies n’avaient pas un impact en termes de rémunération et de carrière en aboutissant vers des secteurs plus précaires et moins porteurs pour les femmes.
C’est pourquoi, pour l’UNSA Éducation, il est primordial d’éduquer dès le plus jeune âge à l’égalité car si les enfants sont exposés à de nombreux discours sur le droit à l’égalité, dans les faits, ces discours sont perpétuellement démentis. Il est donc essentiel d’aller plus loin et de déconstruire les stéréotypes de genre.
La formation des enseignants, enseignantes ainsi que de tous les personnels éducatifs aux questions de l’égalité semble ainsi indispensable. En tant qu’acteurs et actrices éducatifs.ives, nous nous devons de comprendre en quoi les stéréotypes sont de puissants verrous et peuvent être à l’origine d’inégalités pour mieux les combattre. Mais cela nécessite une réelle prise de conscience de toutes et tous.
Ce colloque a permis de mettre en évidence les effets durables de l’orientation sur la précarité des femmes.
Si d’autres domaines ont également été abordés, il apparaît essentiel de renforcer les missions de l’école qui doit aider à résoudre les inégalités sociales en France.
Ainsi, le laboratoire de l’égalité a formulé 9 propositions dans son « pacte sur les stéréotypes » afin d’interpeler les décideurs publics et privés en leur soumettant des pistes d’action concrète.
L’UNSA Éducation ne peut que souscrire à une telle initiative qui concoure à une société plus juste et égalitaire.

L’UNSA Éducation a été reçu au ministère par le ministre de l’Education en compagnie de Pierre Mathiot, Jean Marc Huart (DGESCO), la responsable lycée et sa conseillère sociale.
Après une courte introduction, le ministre explique qu’il y a trois blocs dans le dossier de la réforme : le bac, le lycée et les programmes.
Les annonces qui seront faites le 14 février prochain, concerneront principalement le bac. Il respectera au minimum les engagements du président de la République sur la réduction du nombre d’épreuves.
L’UNSA Éducation a porté les éléments suivants :
Concernant la voie professionelle, nous estimons qu’elle n’aurait pas dû être absente de la discussion. Le ministre indique la DGESCO nous rencontrera de nouveau sur ce point précis.
Concernant le lycée, nous affirmons profondément de ne pas toucher au lycée ! Le contexte, en particulier la carte scolaire second degré, la récupération de moyens, le manque de confiance dans les réformes, font que nous ne sommes pas favorables à ce que l’on fasse évoluer fortement le lycée. Les propositions du rapport Mathiot sur l’architecture du lycée ne nous semblent pas réalistes et ouvrent trop de possibles crispations. Trop de doutes dans ces propositions peuvent faire craindre que l’on aille vers une annualisation du temps de travail. Trop de doutes sur des choix qui pourraient contribuer à lutter contre les inégalités sociales.
Nous pensons aussi que se lancer dans une réforme du lycée empêchera toute réforme du bac.
Concernant la réforme baccalauréat, nous pensons qu’il s’agit d’une priorité car il ne répond plus à sa double mission de valider les acquis de la scolarité et d’ouvrir les portes de la réussite dans l’enseignement supérieur. Son évolution doit avoir pour objectifs la réussite des élèves et une réduction des inégalités sociales. Il doit allier l’exigence d’un diplôme national avec la reconnaissance d’un travail construit par les élèves tout au long du lycée.
Développer une épreuve orale, introduire une part d’évaluation en cours de cycle, favoriser une personnalisation plus grande de l’examen en cohérence avec les attendus des formations de l’enseignement supérieur, sont des leviers qui peuvent progressivement faire évoluer les pratiques pédagogiques et donc à terme changer le lycée.
Après un long échange, le ministre semble très attaché à cet oral qui permettra de mettre en évidence l’esprit critique, la compréhension du Monde de l’élève.
L’UNSA Éducation devra être vigilant sur ce point.
Nous avons alerté sur la nécessité de prendre en compte l’impact de la réforme sur l’ensemble des personnels (conséquences sur le SIEC, conséquence éventuelles sur les personnels ITRF « labos » ).
Dans sa réponse à l’UNSA Éducation, le ministre annonce qu’aucun bouleversement se fera en seconde à la rentrée 2018. Néanmoins, il faudra prévoir des tests de positionnement (sur maitrise de la langue ?), et consacrer l’Aide Personnalisée à la maitrise du français. Un renforcement du travail sur l’orientation devra se faire en lien avec les régions.
Une cellule permanente de la DGESCO a été installée sur ce dossier. Plusieurs sujets sont ciblés sans connaitre les modalités de travail et les délais.
En conclusion :
Pour l’UNSA Éducation, les conditions ne sont pas réunies pour mettre en place immédiatement, au risque de la précipitation, un lycée modulaire vers lequel il faut tendre progressivement.
Aucune réforme ne peut avoir comme conséquence une dégradation des conditions de travail de l’ensemble des personnels. L’UNSA Éducation n’acceptera pas ainsi de projet qui viserait à annualiser le temps de travail des enseignants. Une réforme du baccalauréat doit favoriser l’école de la réussite, lutter contre les inégalités, permettre l’élévation du niveau de tous les jeunes. C’est à cette aune que nous étudierons avec une grande vigilance les choix du ministre et que nous prendrons alors position avec nos syndicats.