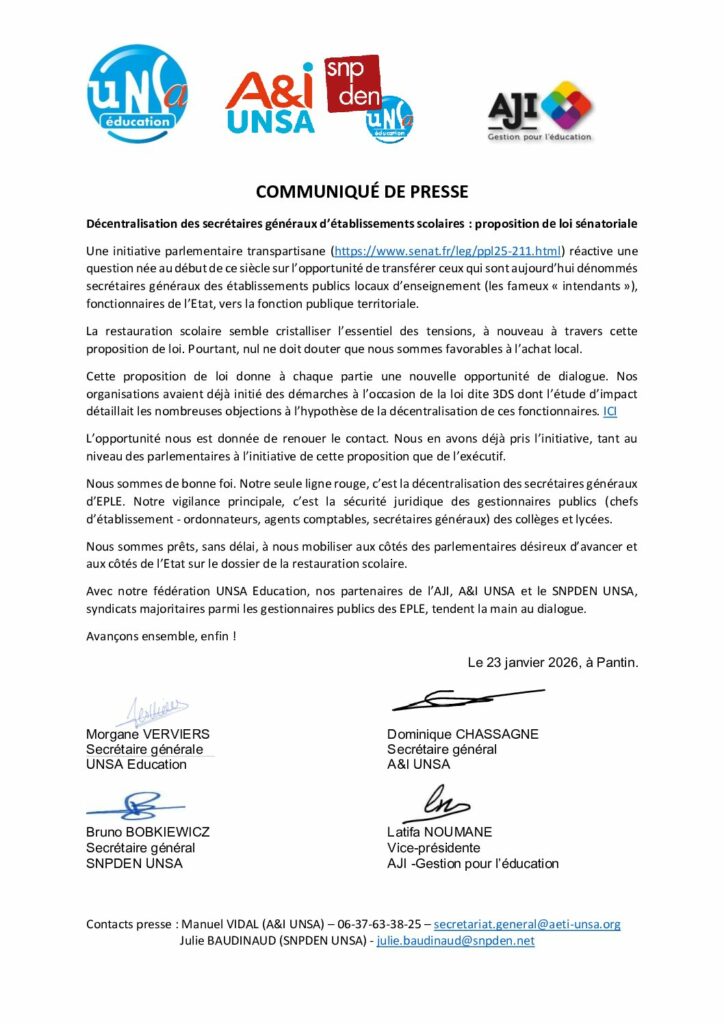Santé mentale au travail, quand l’institution épuise ses agents
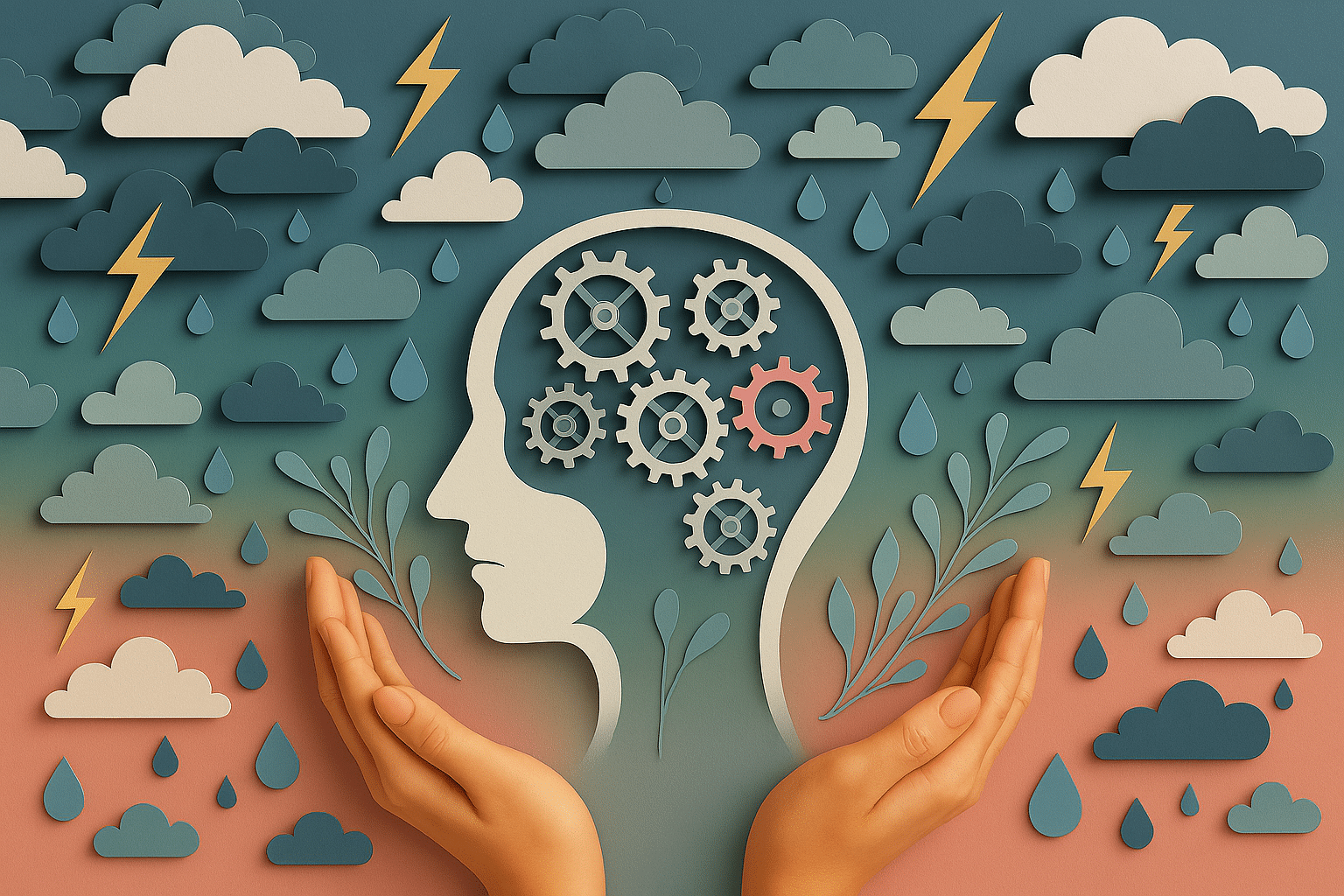
- Conditions de travail dégradées
La fatigue ressentie par les agents ne résulte pas uniquement d’une surcharge ponctuelle. Elle s’inscrit dans une évolution chronique où l’organisation même du travail, les moyens disponibles et le climat professionnel deviennent sources de souffrance. Plusieurs dimensions viennent illustrer cette détérioration progressive.
1.1. Une surcharge de travail chronique et multidimensionnelle
La première cause de souffrance au travail tient à l’environnement professionnel lui-même, qui s’est profondément détérioré au fil des années. De nombreux agents décrivent une charge de travail qui ne cesse de croître, sans moyens supplémentaires pour y faire face L’intensification du travail constitue une réalité largement partagée par les agents. La charge ne se limite plus à la mission principale (enseigner, encadrer, administrer, inspecter, …), elle inclut un empilement de tâches annexes : tableaux de bord, enquêtes, suivi de dispositifs, réunions de pilotage …
À cela s’ajoute une logique de gestion purement comptable : suppressions de postes, mutualisation de services, remplacements non assurés… Les agents se retrouvent à faire « toujours plus avec toujours moins ». Cette réalité nourrit un profond sentiment d’abandon. Elle génère une fatigue chronique, des risques psychosociaux (RPS) bien réels, et, dans les cas les plus graves, des arrêts maladie de longue durée ou des départs précipités.
Ce sont bien les fondations mêmes des conditions de travail qui semblent fragilisées. Et lorsqu’un cadre professionnel devient instable, imprévisible et peu soutenant, il devient un facteur de souffrance pour ceux qui y évoluent.
1.2. La crise du Covid comme accélérateur du malaise
Cette surcharge n’est pas uniquement quantitative ; elle est aussi émotionnelle. Les personnels sont de plus en plus souvent confrontés à des situations complexes, voire violentes. La crise sanitaire a amplifié le malaise des personnels qui, en tant qu’agents du service public, ont dû non seulement affronter leurs propres difficultés, mais aussi prendre en charge la souffrance et le malaise des usagers pendant et après la pandémie.. Le surinvestissement des agents pendant la période du COVID, avec l’enseignement à distance, les réorganisations permanentes et la gestion de l’angoisse collective a laissé des traces durables. Depuis, la pression demeure forte, alimentée par un flot incessant d’annonces, sans que les moyens nécessaires aient suivi.
1.3. Une exposition accrue aux violences et aux incivilités
Les indicateurs présentés dans les bilans SST (santé et sécurité au travail) en formation spécialisée ministérielle montrent que les faits de violences internes ont explosé. Certains métiers du MENJSESR exposent les personnels à des agressions verbales ou physiques. Insultes, menaces, coups, harcèlement … En 2023, les personnels de l’Éducation nationale ont été confrontés à une augmentation inédite des agressions, signe d’une dégradation importante du climat dans les établissements scolaires, avec une hausse de 25 %. Le gouvernement a dû dans l’urgence livrer deux plans pour face à cet accès de violence. Bien que l’Unsa Éducation salue cette démarche, nous restons dans le champ de la prévention tertiaire, c’est-à-dire des mesures qui interviennent une fois que les problèmes sont déjà survenus, sans s’attaquer aux causes profondes. Elles ne règlent donc pas l’origine du malaise et laissent les personnels seuls face à des usagers souvent incompréhensifs et parfois agressifs
La dégradation des conditions de travail se manifeste également en interne. Le travail collectif est fragilisé par la montée des tensions interpersonnelles. Relations dégradées entre pairs, hiérarchies absentes ou autoritaires, rivalités silencieuses … Autant de situations qui, faute d’un cadre de régulation, s’enkystent et deviennent pathogènes.
Plusieurs témoignages évoquent l’absence de médiation, une communication descendante inefficace ou un management perçu comme toxique. Ces environnements de travail délétères ont des effets bien documentés : désengagement, perte d’estime de soi, isolement professionnel.
- Perte de repères et de confiance dans l’institution
La relation entre les agents et leur institution s’est distendue. Entre réformes imposées, manque de soutien et remise en question du sens même des missions, la confiance s’effrite, générant frustration, démobilisation et perte de repères professionnels.
2.1. Des réformes déstabilisantes et mal accompagnées
Les réformes successives, souvent menées sans concertation et accompagnées d’une communication trop descendante, fragilisent les repères construits au fil du temps. Faute de soutien suffisant, la confiance s’érode progressivement, et ce qui devrait renforcer le collectif peine à jouer pleinement son rôle.
Les personnels se retrouvent face à des injonctions paradoxales : individualiser les parcours tout en standardisant les évaluations, faire preuve d’autonomie tout en appliquant strictement des circulaires.
Ce flou génère une perte de sens, un désalignement entre les valeurs professionnelles et les objectifs prescrits. Le résultat : démotivation, retrait, désengagement.
2.2. Une absence de soutien hiérarchique
Le soutien de la hiérarchie est un facteur protecteur bien établi dans la littérature scientifique. Pourtant, les témoignages convergent : les agents se sentent souvent seuls face aux difficultés. Les cadres intermédiaires, eux-mêmes sous pression, peinent à jouer leur rôle d’accompagnement.
Cette carence génère une rupture dans la chaîne de confiance. Elle pousse les agents à adopter des stratégies d’auto-préservation, souvent au détriment de leur engagement ou de leur santé.
2.3. Une remise en cause du rôle de l’école et de ses personnels
Depuis plusieurs années, les personnels observent une transformation profonde du regard que la société porte sur l’école. L’institution scolaire, longtemps perçue comme un pilier de la République, voit désormais son rôle remis en question, voire ouvertement critiqué. Les attentes sociétales à l’égard de l’école sont devenues paradoxales : on lui demande tout (éduquer, intégrer, soigner, prévenir les violences, corriger les inégalités), tout en remettant en cause son autorité, sa légitimité et l’expertise de ses agents.
Ce décalage constant entre les missions confiées et les moyens accordés pèse lourdement sur les personnels. Ils se sentent instrumentalisés, sommés de faire face à une multitude de problématiques sociales sans accompagnement suffisant ni reconnaissance de leur investissement. Par ailleurs, la suspicion croissante à l’égard des institutions, alimentée par certains discours politiques ou médiatiques, renforce le sentiment d’un travail déconsidéré, où les professionnels sont continuellement remis en cause dans leur compétence.
Les enseignants, mais aussi les personnels de direction, d’encadrement ou de vie scolaire, expriment une perte de sens de leur métier. Ils ont parfois le sentiment que le cœur même de leur mission – transmettre, former, faire grandir – est noyé sous une accumulation de tâches périphériques, d’injonctions contradictoires ou d’exigences gestionnaires. Cette remise en cause du rôle de l’école et de ceux qui la font vivre quotidiennement contribue à la fragilisation psychique de ses agents.
- Salaires gelés et avenir professionnel bouché
Au-delà des conditions immédiates d’exercice, les difficultés liées à la rémunération, aux parcours de carrière et à la formation nourrissent un profond sentiment de blocage. Ces éléments jouent un rôle déterminant dans le ressenti d’épuisement et d’injustice au travail.
3.1. Un traitement gelé subissant l’inflation
Le ressenti d’injustice salariale est largement partagé. Gel de la valeur du point d’indice, suppression de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA), suppression de deux jours de congés, engagements non tenus notamment en matière d’alignement des primes par rapport au niveau interministériel, modification du départ de l’âge à la retraite, , différenciation de traitement entre hommes et femmes non résorbée, et enfin la différenciation de prise en compte du nombre de trimestres pour les enfants par rapport au privé arrivée à laretraite: autant d’éléments qui nourrissent le sentiment que la rémunération est décrochée de l’effort réel.
Ce ressenti alimente un désengagement progressif, et nourrit la crise d’attractivité qui touche tous les métiers de nos champs.
3.2. Des carrières sans perspectives
Enfin, les parcours professionnels apparaissent verrouillés. Les concours internes sont rares, les mobilités peu accompagnées, les promotions lentes en raison des taux promus-promouvables faible. De nombreux agents décrivent un plafond de verre invisible, et une impressions d’absence de reconnaissance de leurs compétences ou de leurs expériences.
Cette stagnation crée une forme de désespoir professionnel. Elle alimente la démotivation et fragilise durablement la santé psychique des agents.
3.3. Un déficit chronique de formation continue
Dans un contexte de transformations constantes, l’accès à une formation adaptée est essentiel. Pourtant, nombre d’agents déplorent des offres de formation peu accessibles, mal ciblées ou inadaptées à leurs besoins concrets. Le non-remboursement des frais liés aux déplacements n’encourage pas non plus à partir en formation. L’absence de montée en compétences alimente ainsi un sentiment de décalage entre les exigences institutionnelles et les ressources réelles disponibles. Ce décalage devient un facteur de stress et un frein au développement professionnel.
4. Conclusion
Les causes de la dégradation de la santé mentale ne relèvent pas de fragilités individuelles. Elles sont profondément systémiques. Elles s’ancrent dans l’organisation du travail, la gouvernance, la reconnaissance, les valeurs et les conditions matérielles. Le baromètre de l’UNSA Éducation le confirme également : notre rendez-vous annuels 2025 consacré à la QVCT a mis en évidence la même tendance.
Face à cette réalité, il ne suffit plus de proposer des ateliers de gestion du stress ou des cellules d’écoute. L’UNSA Éducation préconise de repenser les logiques managériales pour restaurer la confiance et rétablir un équilibre soutenable entre exigence et moyens.
Tout le défi de notre employeur est d’inclure la démarche de la qualité de vie et de conditions de travail (QVCT) dans sa politique de ressources humaines. Pour cela il va falloir dépasser le simple stade de l’affichage médiatique et les discours volontariste pour passer aux actes. L’UNSA Éducation s’engage à accompagner toute mise en place d’une nouvelle politique de la QVCT, un vrai cap s’impose.
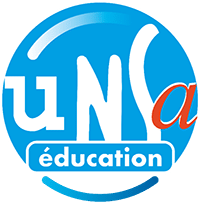
 Nos dossiers
Nos dossiers