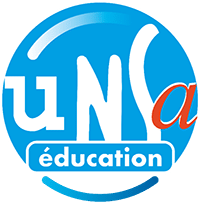Quand la prière s’invite en classe : une remise en cause du principe de laïcité
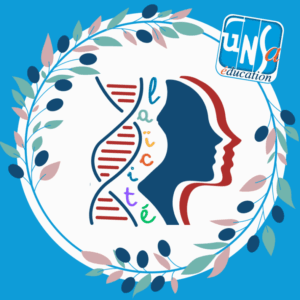
Une atteinte aux principes républicains
Cette offensive, savamment préparée par le SGEC, franchit une ligne rouge : celle qui distingue la liberté de conviction individuelle et la neutralité de l’État. En effet, les établissements privés sous contrat, régis par la loi Debré de 1959, sont soumis, comme les établissements publics, aux principes de neutralité et au respect de la liberté de conscience. La jurisprudence du Conseil d’État a constamment rappelé que cette association contractuelle ne saurait être utilisée pour introduire un enseignement confessionnel en rupture avec la mission de l’école républicaine.
Le vademecum « La laïcité à l’école » rappelle que les célébrations et temps religieux sont facultatifs et surtout en dehors des cours comme le rappelle le CNAL dans son communiqué de presse.
Cette nouvelle provocation intervient au moment même où la République commémore le 120ᵉ anniversaire de la Loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État. Ce texte fondateur assure la liberté de conscience tout en interdisant la reconnaissance ou le financement des cultes par l’État. Il poursuit l’œuvre de laïcisation entamée à l’école par les lois Ferry au début des années 1881/82. D’ailleurs, la laïcité scolaire ne vise pas à effacer le religieux de la société, mais à garantir que l’école demeure un espace d’émancipation préservé de toute pression confessionnelle.
Or, les propos de G. Prévost s’inscrivent dans une stratégie rhétorique qui dépasse le simple débat pédagogique. Ils traduisent le projet d’évangélisation de l’enseignement catholique en réimplantant les pratiques cultuelles au cœur même de l’institution scolaire et, qui plus est, pendant le temps de classe.
Une indispensable remise en cause du modèle d’enseignement du privé confessionnel
L’Église catholique n’a pas encore assumé l’examen critique qu’appellent les scandales récents, notamment celui de Bétharram et, plus largement, les conclusions de la commission parlementaire. Nous ne saurions oublier qu’en juillet 2025, dans les 50 recommandations du rapport Spillebout/Vannier, l’axe 4 proposait de « lever le tabou sur le contrôle des établissements privés». Pourtant, plutôt qu’un travail d’introspection, c’est une forme de surenchère qui semble être privilégiée.
Au fond, les propos déplacés de Guillaume Prévost posent une question essentielle, celle du modèle de l’école de la République. Fidèle à ses valeurs humanistes et de progrès, notre fédération promeut une école qui protège, une école qui accueille toutes et tous sans distinction, une école qui émancipe et rassemble. Notre conception est diamétralement opposée à celle du SGEC. Au-delà du cadre règlementaire lié au contrat d’association, l’enseignement catholique ne doit pas perdre de vue que les établissements sous contrats confessionnels bénéficient à plus de 73 % de financement public. Cette prise en charge inique et insensée d’une forme de concurrence déloyale par la puissance publique devrait amener le porte-parole de l’enseignement catholique à un peu plus de retenue dans ses déclarations.
Pour l’UNSA Éducation, la laïcité ne se réduit pas à une clause juridique, elle constitue une garantie concrète pour tous les élèves, croyants ou non, de recevoir un enseignement émancipateur affranchi de toute pression religieuse. Elle protège les personnels et assure une forme de concorde dont notre pays a besoin. La neutralité scolaire n’est pas à géométrie variable, c’est une condition de la liberté de conscience elle-même ; la sortie du SGEC aura au moins le mérite de pouvoir le rappeler !