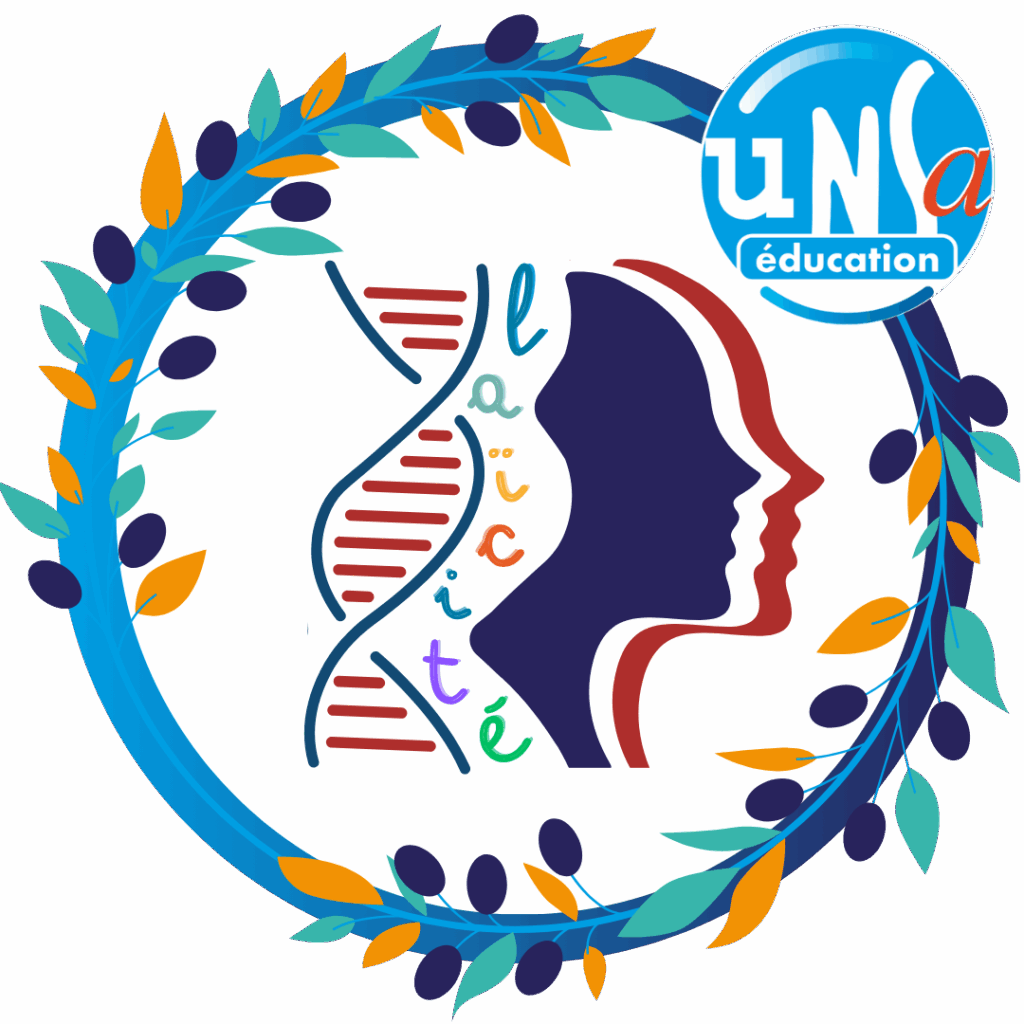Mayotte post Chido : l’école au milieu du chaos

Avant Chido : le premier degré déjà saturé
Bien avant le passage du cyclone, les conditions d’enseignement à Mayotte étaient déjà « particulièrement difficiles ». Le problème central : une démographie hors de contrôle. Selon des estimations, 57 % de la population vit en situation irrégulière, ce qui rend toute planification impossible. Les chiffres officiels annoncent 320 000 habitants, mais la réalité pourrait s’approcher de 500 000, voire 600 000 personnes. Autrement dit, les infrastructures scolaires, sanitaires et sociales sont dimensionnées pour une île deux fois moins peuplée.
Faute de locaux, de nombreuses communes pratiquaient les doubles vacations dans le premier degré : une première session d’enseignement le matin, une seconde l’après-midi. Dans la quasi-totalité des communes des l’îles, ce système est devenu la norme.
On commence à 7h avec la première équipe d’élèves, on enchaîne à 13 h avec la deuxième, et on finit à la tombée de la nuit.
Certaines écoles comptent jusqu’à 1 500 élèves. Les effectifs explosent, les locaux sont vétustes, et l’eau manque jusque dans les établissements.
Rien n’est dimensionné pour la population réelle. Encore aujourd’hui, les coupures d’eau sont quotidiennes : certains villages n’y ont accès qu’un jour sur quatre ou cinq.
Le cyclone Chido a aggravé une situation déjà critique. Toitures arrachées, routes coupées, écoles endommagées : l’infrastructure éducative a été lourdement touchée. Dans certaines zones, l’eau et l’électricité ont mis des semaines à revenir. Face à la saturation, de nouveaux modes d’organisation sont apparus :
On a inventé un système de triple rotation : matin, midi, soir.
Mais cette « adaptation d’urgence » ne peut masquer la réalité : les conditions d’enseignement se dégradent, les élèves et les personnels s’épuisent.
Le second degré à la limite de la rupture
Si le premier degré parvient encore à fonctionner grâce à des systèmes de rotations doubles voire triples, la situation dans le second degré devient critique. Avec une croissance démographique continue (près de 11 000 naissances par an), la pression sur les collèges et les lycées est désormais insoutenable.
Le premier degré va nous exploser à la figure. Mais derrière, c’est le second degré qui ne pourra pas suivre.
Les collèges et lycées ne peuvent pas fonctionner en rotation. Les contraintes d’emploi du temps, les examens nationaux et la diversité des enseignements rendent ces adaptations impossibles. Certains collèges dépassent déjà 1 800 élèves, avec près de 80 classes, quatre CPE, trois personnels de direction et plus de vingt assistants d’éducation pour tenter de maintenir le cap.
Les bâtiments manquent, le foncier est rare, les budgets insuffisants. Sans un plan massif de construction et de moyens humains, le second degré mahorais risque de s’effondrer sous le poids de sa propre démographie. Une crise annoncée depuis des années, que le cyclone Chido n’a fait qu’accélérer.
Des conditions de vie indignes
Les conditions d’apprentissage sont indissociables des conditions de vie.
De nombreux enfants grandissent dans des bidonvilles, sans eau courante ni électricité, dans des maisons de tôle moins confortables que les favelas de Rio.
L’accès aux soins est saturé : il faut parfois faire la queue dès trois heures du matin devant les cabinets médicaux, et les routes, engorgées, transforment chaque trajet en épreuve.
Beaucoup d’enfants scolarisés dans le second degré se lèvent avant l’aube. Certains prennent le bus à 3h30 du matin pour arriver à 6 h au collège ou au lycée.
La journée est interminable : cours, retour en bus dans les embouteillages, puis un coucher souvent après 20 h. Le repas du jour ? « Un petit bout de pain de 20 cm avec du céleri rémoulade » fourni par le service de demi pension. La fatigue, la malnutrition et la promiscuité rendent l’apprentissage presque impossible. Pourtant, les enfants continuent à venir. « Les gamins ont été d’une résilience absolue.»
Violences, pillages et peur du retour des pluies
Le contexte social est explosif. La violence, notamment sur les routes, inquiète. Les agressions, les « caillassages », les blocages se multiplient. Des jeunes déscolarisés, livrés à eux-mêmes, se regroupent en bandes.
Quand on a des gamins qui ont connu la faim, la peur, la nuit sans lumière, leur priorité, ce n’est pas de résoudre une équation du second degré. C’est de survivre.
Dans ces conditions, l’école ne peut jouer pleinement son rôle. Les inégalités se creusent, le désespoir gagne du terrain. Pourtant, chaque jour, des milliers d’enfants franchissent les grilles d’établissements surpeuplés, toujours l’envie d’apprendre.
Dans les jours qui ont suivi le passage du cyclone Chido, Mayotte a connu une période de chaos. Les pénuries déjà chroniques se sont transformées en crise ouverte : plus d’eau, plus de denrées alimentaires, plus de matériaux. Le vent et les inondations avaient tout emporté, et ce qui restait a souvent été pillé. Les écoles, les dispensaires et les centres de soins n’ont pas été épargnés. Des salles de classe se sont retrouvées dévalisées, les vitres brisées, les fournitures et le mobilier disparus.
Tout ce qui pouvait servir à réparer un toit ou à se protéger a été pris.
À la pénurie de vivres s’est ajoutée celle de matériaux de construction : impossible de trouver des tôles, des clous, du ciment ou du bois. Les chantiers de réparation sont restés bloqués, tandis que des familles entières vivent encore sous des bâches plastiques, improvisant des abris avec des débris.
Et la saison des pluies qui commence fait craindre le pire. Beaucoup n’ont toujours pas retrouvé de toit solide. Les enseignants redoutent de devoir, à nouveau, accueillir des élèves trempés, malades, parfois affamés. Les écoles, déjà fragilisées, risquent de se transformer en refuges de fortune.
L’école comme refuge, les personnels en première ligne
Dans ce contexte, l’école est bien plus qu’un lieu d’instruction. Elle devient le seul repère stable dans un quotidien chaotique. Les élèves y trouvent un espace de sécurité, d’attention, de normalité. Les personnels, eux, tiennent bon, souvent au prix de leur santé.
Les gens qui peuvent partir s’en vont. Ceux qui restent ont l’école républicaine vissée au corps.
Mais la fuite des personnels est continue. Beaucoup ne restent que deux ans, souvent moins, avant de demander une mutation. Comment le leur reprocher ? Le manque d’enseignants qualifiés pousse à recruter loin, y compris hors de France, parfois avec des diplômes peu vérifiables. La formation, la maîtrise du français, les repères pédagogiques : tout cela devient un enjeu majeur.
L’urgence d’un plan global
L’UNSA Éducation alerte depuis des années sur la situation structurelle d’urgence à Mayotte. Les réponses ponctuelles, les renforts temporaires, les dispositifs spécifiques ne suffisent plus. Le cyclone Chido n’a pas créé la crise de l’école mahoraise : il en a montré la profondeur. Les conditions de vie indignes, la pauvreté extrême, la pression démographique et la fuite des personnels menacent le droit fondamental à l’éducation.
Il faut un plan global :
- un programme massif de construction scolaire et de rénovation,
- un recrutement pérenne d’enseignants formés,
- une politique sociale ambitieuse pour le logement, la santé, les transports,
- et une prise en compte réaliste et effective de la démographie de l’île.
Il ne s’agit pas seulement de scolariser, mais de donner les moyens d’apprendre et de vivre dignement.
« Ici, on apprend à survivre avant d’apprendre à lire »
Dans chaque classe, chaque enseignant qui reste, chaque enfant qui sourit en arrivant, malgré la pluie, la peur ou la faim est un acte de résistance. C’est à cette résilience que l’UNSA Éducation rend hommage, tout en rappelant à l’État sa responsabilité : Mayotte fait partie de la République, et le droit à l’éducation ne peut y être une promesse différée.
A lire également
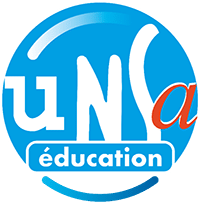
 Analyses et décryptages
Analyses et décryptages