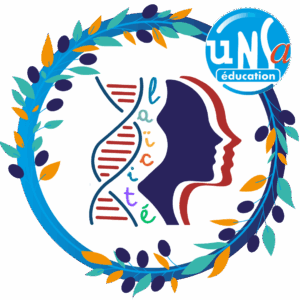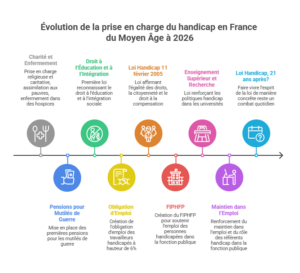L’Europe, tout de suite et jusqu’au bout

L’histoire de la construction européenne est celle d’un cheminement fait d’accélérations, de temps morts et de doutes. Pourtant, elle est aujourd’hui une réalité incontournable de notre quotidien. L’Union européenne n’est plus une idée lointaine : elle est un acteur public et international qui compte, capable de faire la différence en période de crise, comme l’a montré sa réaction face à la pandémie de COVID-19. Sur le plan géopolitique, si cette puissance est plus fragile, l’Europe (l’UE et ses partenaires que sont la Grande-Bretagne et la Norvège, entres autres) parvient plus souvent à faire entendre une voie mesurée, constante, utile sur la scène internationale, même si c’est à plusieurs voix.
Pourtant, l’actualité récente vient questionner cet équilibre précaire. La guerre d’annexion menée par la Russie en Ukraine et le désengagement des États-Unis, sous l’impulsion de Donald Trump, bouleversent l’ordre mondial. L’Europe se retrouve face à un double défi : assumer sa propre sécurité tout en préservant son modèle démocratique.
Les extrêmes politiques cherchent à nous enfermer dans un faux débat : celui d’un choix imposé entre souveraineté et solidarité, entre réarmement et justice sociale. Ainsi, à l’extrême gauche, certains prônent un souverainisme pacifiste déconnecté des réalités du monde. Alors qu’à l’extrême droite, la fracture est totale entre les nostalgiques d’un alignement pro-américain et ceux qui voient en Poutine un modèle.
Ne nous trompons pas de combat. Il nous faut plus d’Europe, mieux d’Europe, et surtout une Europe qui ne se renie pas elle-même. Actualisons les mots de Robert Schuman qui disait en 1950, « L’Europe n’a pas été faite, nous avons eu la guerre » : si l’Europe n’est pas faite, nous aurons la guerre. Il faut entendre ici, si l’Europe n’est pas faite jusqu’au bout.
Alors oui, nous avons besoin d’une Europe de la défense, capable de sa propre protection et de celle de tous ses pays membres. Parce qu’une ambition diplomatique doit s’accompagner de moyens d’intervention forts pour être convaincante. Nous devons assumer un investissement fort dans notre sécurité, avec une réindustrialisation à la hauteur et un engagement clair pour un matériel de défense conçu et produit en Europe. Mais cette ambition ne peut être un prétexte à une dérive libérale où le financement du réarmement se ferait au prix du démantèlement de notre modèle social.
Rappelons aussi, que la dimension militaire ne peut suffire. Garantir la paix européenne c’est également assurer la protection de l’ensemble de ses habitants. La sécurité des Européens ne se mesure pas seulement en missiles et en chars. Une véritable souveraineté repose sur un socle de protections : services publics solides, accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à la formation. L’économie de guerre ne doit pas se traduire par un sacrifice de notre modèle européen et de l’idée même de progrès social s’appuyant, entre autres, sur une harmonisation fiscale et en termes de mieux-disant salarial.
À l’Europe de la défense doit correspondre l’engagement renouvelé à construire une société plus juste et équilibrée. L’économie dite « de guerre », comme économie qui sort de la logique de consommation et de rentabilité pour donner la priorité à des enjeux d’urgence, doit être équilibrée par une économie qui assure à chaque européenne et européen de bien vivre en Europe. Elle doit faire face à l’urgence et à d’autres enjeux déterminants. La crise sanitaire en était un. Le changement climatique aussi. Cela passe obligatoirement par un investissement financier collectif à la hauteur des enjeux.
Enfin, l’UNSA Éducation, de par tous les métiers qu’elle représente, souligne qu’à l’Europe de la défense doit correspondre une Europe de l’intelligence. Par la recherche, l’innovation, la capacité de nos citoyens à comprendre et à agir. Investir dans l’éducation, la recherche, et la culture, c’est investir dans le présent et l’avenir de notre continent. C’est donner aux Européens les moyens de bâtir des perspectives qui ne se résument pas à des choix imposés par d’autres puissances.
Une Europe où chaque citoyen se sent acteur de son destin, où la démocratie n’est pas seulement un principe mais une réalité vécue. Une Europe qui ne se définit pas seulement par sa capacité à se protéger, mais aussi par sa volonté de construire un projet collectif ambitieux. Comme notre union, l’UNSA Éducation porte cette ambition au sein des instances syndicales européennes. Depuis sa création, l’UNSA a toujours affirmé son ADN réformiste, laïque, humaniste et résolument européen. Ce choix, nous le revendiquons aujourd’hui avec encore plus de force : une Europe forte, garante de la qualité de vie, du progrès pour toutes et tous et de la paix.
Morgane Verviers
Secrétaire générale de l’UNSA Éducation
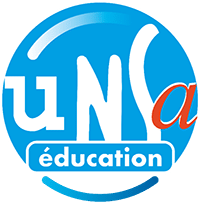
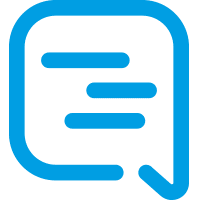 Nos expressions
Nos expressions