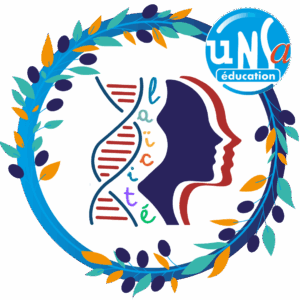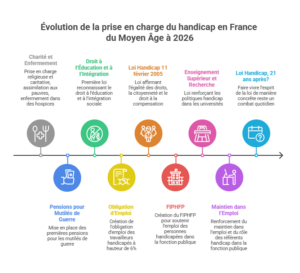« L’attention, un pari sur l’avenir »

Quelle définition donnez-vous de l’attention ?
L’attention est une fonction du cerveau, ou plus largement du système cognitif, présente chez tous les animaux, et notamment chez les humains. Comparativement à d’autres espèces, notre capacité attentionnelle est plutôt faible. Les chimpanzés, par exemple, disposent d’une meilleure attention que nous.
L’attention est avant tout une fonction de sélection des informations présentes dans notre environnement. Les informations que l’on sélectionne, on les traite de manière plus précise, plus efficace et plus profonde. Mais comme il s’agit d’une sélection, elle se fait nécessairement au détriment d’autres informations. On pourrait donc dire que l’attention est à la fois une fonction de sélection et une fonction d’inhibition des informations qui ne nous intéressent pas.
Pourquoi l’attention est-elle si importante pour apprendre et pour enseigner ?
Parce que ce qu’on apprend à l’école n’a quasiment rien à voir avec ce qu’on apprend dans la vie quotidienne.
Notre cerveau a eu le temps, depuis les débuts de l’Homo sapiens, d’évoluer pour que nous apprenions naturellement certaines choses : parler, reconnaître des visages, identifier des expressions émotionnelles, catégoriser les espèces animales autour de nous, etc. Bref, tout ce que les humains apprennent depuis 200 000 ans peut s’acquérir par simple immersion, sans école.
Mais l’école, elle, s’occupe d’apprentissages qui ont deux caractéristiques très particulières :
Ils sont récents dans l’histoire de l’humanité.
Les mathématiques, l’histoire, la philosophie, l’écriture… notre cerveau n’a pas eu le temps d’évoluer pour les apprendre naturellement. Par exemple, il existe dans le cerveau des zones spécialisées pour le langage oral (aires de Broca et de Wernicke), mais il n’y a pas de « zones des mathématiques » ou « zones de l’histoire », pas même de « zone de l’écriture ».
Ils sont “inutiles” à court terme.
Un apprentissage scolaire ne rapporte pas immédiatement… il ne donnera pas plus de frites à la cantine, il ne fera pas de moi une meilleure personne du jour au lendemain. Les apprentissages scolaires prennent sens parfois après quelques jours, parfois des années plus tard, dans un autre pays, une autre vie, une autre situation. Ce sont des savoirs qui relèvent d’un pari sur l’avenir, et non d’une utilité immédiate.
Ces deux caractéristiques expliquent pourquoi les apprentissages scolaires sont extrêmement exigeants sur le plan attentionnel. On ne peut pas apprendre ces connaissances si l’on n’a pas ses ressources attentionnelles focalisées sur elles.
Quelles indications la recherche donne-t-elle aux enseignants pour favoriser l’attention des élèves ?
Il faut travailler sur la manière dont l’enseignant prépare ses cours et conduit sa classe. Cela passe par deux choses essentielles :
Réduire les informations superflues ou décoratives, pour se centrer sur ce qui est réellement important.
Accroître l’engagement des élèves : les amener à se questionner, à établir des inférences, plutôt qu’à se contenter de mémoriser. C’est ce qu’on appelle des traitements profonds, qui mobilisent davantage l’attention.
Un exemple : si je veux faire travailler mes élèves sur une notion d’histoire, je dois me demander si le document choisi est réellement le meilleur pour atteindre cet objectif, ou si un autre document, moins exigeant en termes périphériques, ne serait pas plus adapté. L’important, ce n’est pas le document en lui-même, c’est la notion que je veux enseigner. Idem en mathématiques : pour découvrir une propriété, certains problèmes sont plus complexes que d’autres, or ce qui compte, c’est bien la propriété à acquérir.
Ces choix pédagogiques recentrent le travail sur l’engagement, le sens, la motivation, qui sont intimement liés à l’attention.
Quelle différence faites-vous entre attention et motivation ?
L’attention vraiment cruciale pour les apprentissages scolaires est l’attention volontaire : celle que l’apprenant décide de mobiliser. Elle est très éloignée des apprentissages naturels (comme l’acquisition de la langue orale) qui ne nécessitent ni effort ni motivation particulière.
Apprendre à lire, par exemple, demande un effort volontaire, surtout si l’on rencontre des difficultés. La motivation n’est qu’un moyen d’augmenter cette attention volontaire. Elle est efficace parce qu’elle permet de s’engager, mais c’est bien l’attention qui reste décisive.
Et les écrans ? Les smartphones détruisent-ils l’attention ?
On entend souvent ce raccourci, mais il est trompeur. Ce n’est pas le smartphone en soi qui « flingue » l’attention, c’est l’usage qui en est fait. Les écrans sont surtout des distracteurs parmi d’autres, une couche supplémentaire dans un environnement déjà saturé d’informations.
Dans la nature, dans une ville ou même ici, pendant cette interview, la quantité d’informations disponibles est phénoménale. L’attention sert à filtrer, et si quelqu’un prononce mon prénom à l’autre bout de la salle, je vais l’entendre, même si je n’écoutais pas la conversation voisine. C’est une fonction d’alerte, essentielle pour la survie.
La vraie question est ailleurs : pourquoi certains individus, enfants ou adultes, choisissent-ils de regarder leur smartphone pendant un repas familial plutôt que de participer à la conversation ? Là encore, tout est affaire de décision. On peut décider de couper les notifications ou de poser son téléphone.
L’important est d’apprendre à accompagner les enfants dans ces choix, à leur montrer les conséquences de leurs décisions.
Vous insistez donc sur l’idée d’« éducation à l’attention » ?
Oui. C’est essentiel d’apprendre aux élèves que c’est eux qui décident de ce sur quoi ils portent leur attention. Cela redonne du pouvoir, au lieu de les enfermer dans un discours fataliste du type « les algorithmes nous gouvernent ». Les algorithmes sont conçus par des humains, qu’ils soient attractifs, c’est certain. Mais si nous les laissons « nous manger », c’est bien parce que nous les laissons faire.
Il faut toujours rappeler que notre capacité attentionnelle a évolué pour repérer dans un environnement saturé ce qui est vital : le prédateur, la proie, la source de nourriture. Cela explique aussi pourquoi nous pouvons avoir des peurs disproportionnées : il vaut mieux, du point de vue de l’évolution, avoir peur pour rien que rater un signal de danger réel.
En conclusion ?
Il faut accompagner les élèves, les aider à comprendre qu’ils ont ce pouvoir de décider. L’attention volontaire est une ressource exigeante, mais décisive.
L’éducation à l’attention, c’est leur apprendre à en faire usage, non pas par contrainte, mais comme un outil d’émancipation.
Propos recueillis par Stéphanie de Vanssay pour l’Unsa-Éducation
Crédit photo : Lyonel Kaufmann pour LUDOVIA#22
Pour aller plus loin :
➡️ Vidéo de la conférence donnée par André Tricot le 26 août à Ludovia : “Attention et participation en classe avec le numérique”
➡️ Synthèse de la conférence sur le site de Ludovia
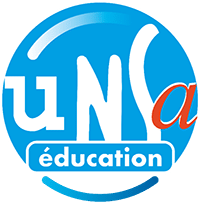
 Analyses et décryptages
Analyses et décryptages