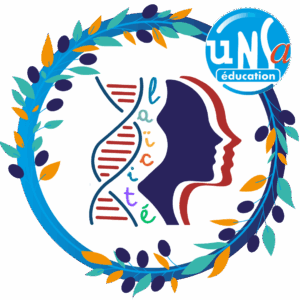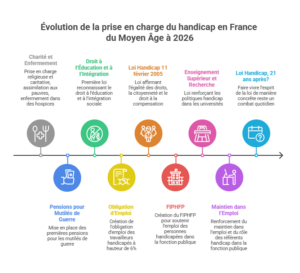Laïcité : socle républicain ou arme politique ?
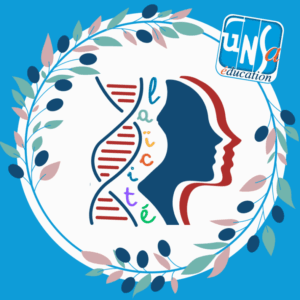
Un cadre juridique en constante adaptation
La laïcité est un principe ancré dans la loi du 9 décembre 1905 portée par Aristide Briand et sa volonté de concorde. En dépit des interprétations, elle est soutenue par deux piliers irrévocables : la neutralité de l’État, et la liberté de conscience. Il n’en reste pas moins que son cadre a évolué avec le temps. En effet, même si elle est parfois considérée comme telle, la laïcité n’est pas une valeur. Les valeurs, c’est ce qui donne du sens à notre projet commun, autrement dit la liberté, l’égalité et la fraternité. Le principe, en l’occurrence la laïcité, c’est ce qui rend possible la mise en œuvre des valeurs de notre ambition commune avec les moyens afférents : la séparation et la neutralité de l’État. Ainsi la mise en œuvre des principes de laïcité est-elle de facto évolutive, utilise-t-elle des modalités diverses et évolue-t-elle avec le droit. Pourtant, des lectures et interprétations différentes, des nuances traversent le camp laïque offrant des débats passionnants sur le plan intellectuel mais faisant perdre de vue parfois la nature même et la finalité du principe de laïcité.
Le principe de laïcité au cœur de la construction de l’école publique
Depuis 1953, le Comité National d’Action Laïque (CNAL) joue un rôle déterminant dans la défense de l’école publique face aux tentatives de privatisation. Ses membres (FCPE, fédération des DDEN, Ligue de l’enseignement, Unsa Education et SE-Unsa) œuvrent de conserve depuis des décennies pour porter la voix de l’école publique face aux offensives de l’enseignement confessionnel. Un de ses plus importants épisodes eut lieu dans les années 1980 autour du financement public de l’enseignement privé confessionnel lors de la bataille de l’école dite « libre ». Des gages inconsidérés ont été octroyés à une école privée confessionnelle qui étend sans cesse sa zone d’influence. Jour à après jour, le privé essaie de gagner du terrain sur les pratiques cultuelles à l’école ou sur sa place dans la formation.
Au XXIe siècle, plusieurs lois ont redéfini ou précisé les contours du cadre juridique de la laïcité. La loi du 15 mars 2004 « encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics » en est probablement l’exemple le plus marquant. Aujourd’hui, le débat se poursuit et s’étend à de nouveaux domaines de l’éducation populaire ou de l’enseignement supérieur. Ainsi voit-on ressurgir des discussions enflammées autour de la laïcité dans le sport ou à l’université. Mais si le contexte de droitisation de la société et la recrudescence des replis identitaires ont fait se focaliser le débat sur l’Islam, les questions relatives à la laïcité trouvent une traduction pratique sur des champs moins médiatisés. C’est le cas en Bretagne où les projets actuels pourraient laisser la formation initiale et continue des professeur.e.s au réseau privé confessionnel ! Concrètement, l’Inspe de Vannes et son antenne sur Lorient n’accueilleraient plus de nouvelle formation d’enseignant·es. Une seule licence de professorat des école serait mise en œuvre dans le service public de l’académie. Des étudiant.e.s, boursiers pour la plupart, seraient donc sommé.e.s de choisir entre des surcoûts de transport pour suivre un enseignement public ou se tourner vers l’Université Catholique… C’est absolument inacceptable.
Une histoire jalonnée de ruptures et d’affirmations
Avant même 1905, les lois scolaires de Jules Ferry, en 1881-1882, avaient amorcé la laïcisation de la République : école gratuite, obligatoire, et laïque, sans instruction religieuse. Ces réformes, portées par des républicains convaincus comme Paul Bert ou Jean Macé, visaient à former des citoyens émancipés de toute tutelle spirituelle.
La loi de 1905 vient entériner cette logique en séparant définitivement les Églises de l’État. Mais la laïcité n’est pas pour autant figée !
La laïcité est interrogée notamment à des périodes graves comme lors des assassinats de Samuel Paty en 2020 et de Dominique Bernard en 2023. Ils ont constitué des traumatismes collectifs majeurs pour l’institution scolaire, mettant en lumière notre vulnérabilité face aux tensions religieuses et idéologiques. Ces événements ont renforcé la conscience du risque encouru par les enseignant.e.s lorsqu’ils essaient quotidiennement de transmettre les valeurs de liberté d’expression et de pensée critique. Toutes et tous peuvent être traversés par un sentiment d’insécurité voire des velléités d’autocensure. De même, pour nos élèves, ces drames ont réactivé la question du rapport à la République et au pluralisme des convictions, soulignant la nécessité d’un travail pédagogique renouvelé sur la laïcité comme condition du vivre-ensemble et de l’émancipation. L’Institution a réaffirmé politiquement et symboliquement la laïcité scolaire, par le biais de commémorations, de formations renforcées et d’un cadrage plus strict du discours éducatif autour des valeurs républicaines.
Au fond, à chaque moment de crise, la laïcité devient un terrain d’affrontement entre conceptions plus ou moins tranchées du « vivre-ensemble ». La République réaffirme, dans ces moments de tempête, un horizon fidèle aux fondements du pacte républicain.
La laïcité falsifiée ou l’arme politique d’un repli identitaire
Depuis plus d’une décennie, la laïcité est souvent invoquée non pour garantir l’égalité, mais pour cibler une religion en particulier, l’Islam. Cette dérive est particulièrement exploitée par l’extrême droite, qui en fait un outil de stigmatisation. Le rassemblement national et ses partis satellites brandissent la laïcité comme un rempart contre l’« islamisation », en trahissant son essence qui reste la neutralité de l’État vis-à-vis de tous les cultes.
L’instrumentalisation politique du principe menace sa légitimité. Il cesse dès lors d’être un espace commun pour devenir un moyen d’exclusion. Pourtant, elle fut pensée, dès ses origines, comme un principe de concorde, d’apaisement, garant de la liberté pour tous, au-delà des croyances.
Pour l’UNSA Éducation, la laïcité est un principe qui permet l’émancipation, et pas seulement un outil de coexistence. La laïcité n’est ni une arme d’exclusion, ni une citadelle coupée des réalités sociales. C’est un cadre juridique et politique vivant. Il est le fruit de combats historiques et d’arbitrages constants impliquant juristes, historiens, militants et acteurs de la société. La laïcité est surtout un pilier fondamental de l’école publique, garantissant une éducation libérée de toute influence religieuse ou dogmatique.
Pour notre fédération fondamentalement progressiste, la laïcité est un outil essentiel dans la lutte contre l’obscurantisme, et pour l’émancipation de la jeunesse. Elle ne se réduit pas à un simple principe de coexistence pacifique. En effet, elle permet à chacun.e, dès l’enfance, de penser librement, de se forger un esprit critique, et de devenir acteur d’une société éclairée. Cet objectif ambitieux ne saurait être détourné, ni relativisé à la faveur d’instrumentalisations politiques.
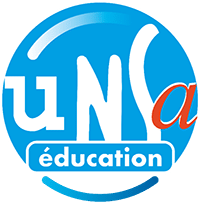
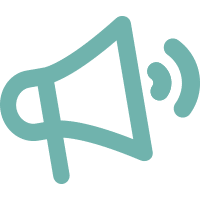 En lien avec l'actualité
En lien avec l'actualité