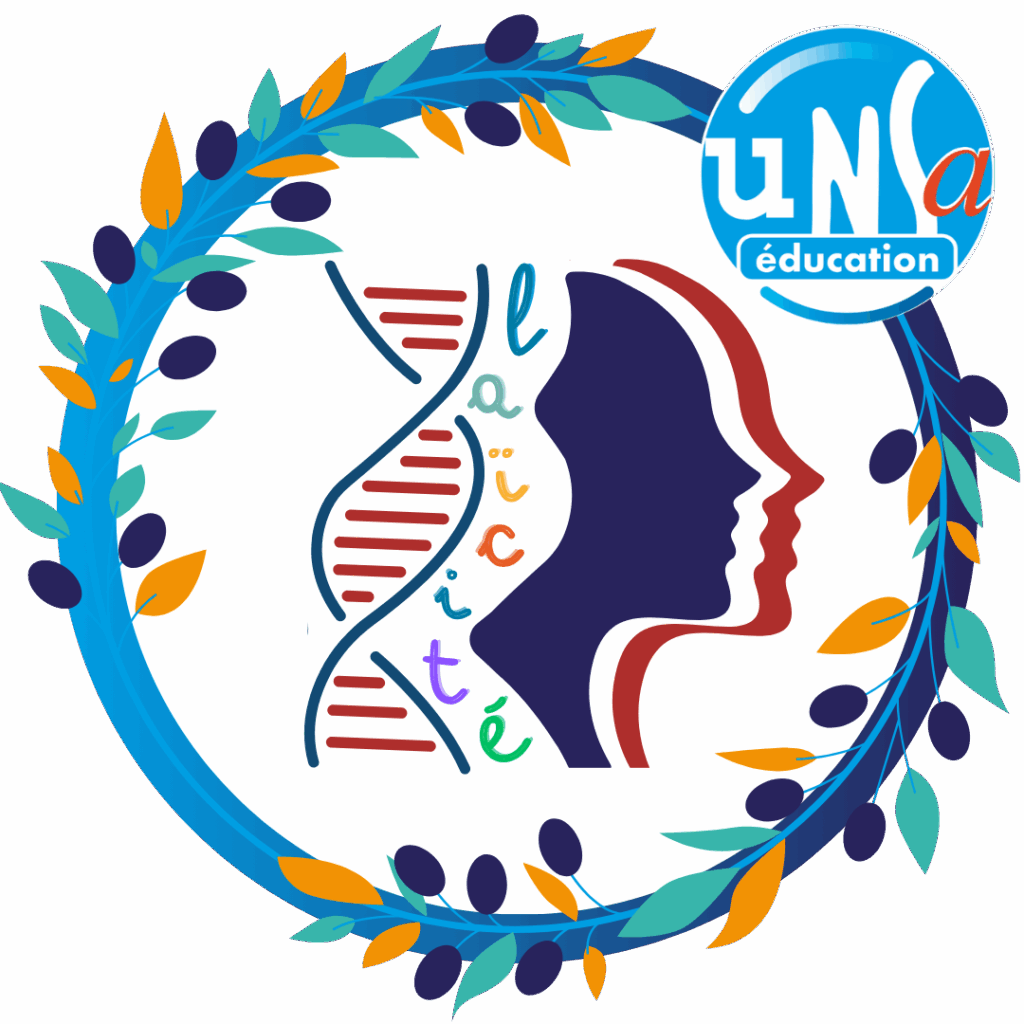L’accueil d’étudiants étrangers, fondement d’une diplomatie de la connaissance

Et pourtant ! Dans le respect de toutes les cultures, en diffusant les bénéfices de la liberté, de la culture, de la science, mais aussi, dans l’acceptation de leurs responsabilités dans l’Histoire, les États peuvent contribuer à réduire les tensions internationales et à renforcer les possibilités pour l’Humanité de répondre aux crises existentielles qui lui font face. Plus que jamais, les États démocratiques, et tout particulièrement la France et l’Europe, n’ont donc d’autre choix que celui d’essayer de défendre leur modèle. Non par la force donc, mais par l’exemple. Au premier rang des instruments de ce soft power se trouvent la coopération scientifique et l’internationalisation de l’enseignement supérieur et, au cœur de ceux-là, l’accueil des étudiantes et étudiants étrangers1.
Lors des élections présidentielles de 2022, l’UNSA Éducation plaidait déjà pour que l’Europe assoit sa diplomatie et son modèle démocratique et revendiquait, notamment, que “Les établissements européens doivent partager leurs ressources, notamment pédagogiques et scientifiques, et ouvrir gratuitement le maximum de celles-ci aux citoyennes et citoyens du monde. La diffusion de notre culture humaniste et scientifique est un instrument de première importance de la diplomatie européenne, nul ne doit la mésestimer”. Alors que la place de l’Europe au sein du concert des nations se retrouve de plus en plus marginalisée et affaiblie, cette revendication s’avère d’autant plus justifiée. Se pose donc la nécessité de mieux comprendre le contexte mondial actuel sur cet aspect mais aussi, de mesurer les dynamiques actuelles de la mobilité étudiante en France pour entrevoir les moyens de les favoriser .
Brèves considérations sur le contexte mondial de la mobilité étudiante
Si la diplomatie de la connaissance passe indubitablement par la mobilité étudiante, la réciproque n’est pas toujours vraie. Pour le dire autrement : quand certains pays cherchent à développer la mobilité étudiante, leur objectif premier n’est pas de renforcer leur diplomatie. Peut-être parce qu’ils ont déjà gagné la bataille de l’hégémonie culturelle2 dans l’enseignement supérieur, de nombreux pays, notamment les États-Unis (USA), ont fait de l’accueil des étudiants étrangers une activité que l’on peut qualifier de marchande. La contribution dans l’économie américaine des étudiantes et étudiants étrangers aux USA représentait en 2022-2023 plus de 40 milliards de dollars. Le modèle économique des universités américaines repose en grande partie sur les frais d’inscription que payent les étudiantes et étudiants étrangers afin d’y suivre leur cursus. Comme le relève le New York Times (27 mai 2025) :
“Many universities in the United States rely on foreign students to pay full tuition. Those students are responsible for a substantial portion of the annual revenues of many American universities. On some campuses, foreign students make up the majority of researchers in certain disciplines, mainly in the sciences.” 3
New York Times 27 mai 2025
Ce modèle a toutefois montré sa fragilité. En 2020, la pandémie de covid a d’ailleurs éprouvé le modèle anglo-saxon de l’enseignement supérieur. Avec les différents lockdowns (confinements), les établissements dans l’incapacité d’accueillir les étudiantes et étudiants étrangers se sont retrouvés en difficultés financières. En Australie4 ou en Grande Bretagne5, par exemple, les universités ont vu leurs ressources grandement impactées et se sont retrouvées en difficultés. Si ce modèle économique de l’accueil d’étudiants étrangers n’aura finalement pas été balayé, la pandémie a malgré tout été un moment où la marchandisation de l’enseignement supérieur a sérieusement été questionnée.
La Chine a suivi une stratégie différente. Dès les années 1980, afin de consolider son développement économique et son passage à l’économie de marché, la Chine a fortement encouragé la mobilité étudiante sortante. À cette époque, l’enseignement supérieur et la recherche chinois étaient en retrait par rapport à ceux de l’occident. La Chine a donc autorisé à un grand nombre des ses ressortissants d’aller se former dans les meilleures universités tout en les incitant à revenir ensuite au pays6. Cette politique a permis d’accélérer non seulement le développement économique de la Chine, mais aussi de son système d’enseignement supérieur et de recherche. À ce jour, la Chine est désormais une puissance scientifique incontestable, disputant, selon les critères, la première place mondiale avec les USA. Notons tout de même que, en dépit de ses efforts, la Chine peine à attirer des étudiants étrangers hors du continent asiatique, ce qui limite son influence culturelle.
Évolution de la mobilité étudiante en France
- mobilité entrante :
Comme nous l’avons rappelé, la pandémie de COVID a eu un impact notable dans la mobilité internationale étudiante. En France, la dynamique des dernières années est donc elle aussi marquée par les différents confinements mondiaux, mais demeure très positive. Notre pays se place ainsi comme une destination privilégiée des étudiantes et étudiants du monde. Les dernières données de Campus France7 montrent qu’avec plus de 430 000 étudiantes et étudiants étrangers (année 2023-2024), la France est la 6e nation d’accueil au monde. Ces effectifs d’étudiants en mobilité entrante représentent pratiquement 15% des effectifs inscrits de l’enseignement supérieur français. La croissance de cette mobilité est notable et atteint +4,5% sur 1 an et +17% sur 5 ans (2018-2019).
Les 10 principaux pays d’origine des étudiants qui suivent leur cursus en France sont, dans l’ordre d’importance : le Maroc, l’Algérie, la Chine, l’Italie, le Sénégal, la Tunisie, l’Espagne, le Liban, la Côte d’Ivoire et le Cameroun. Ceci souligne d’un côté les bonnes relations de partenariat de la France avec les pays africains et l’importance de la francophonie, mais d’un autre, la relative faible mobilité intra-européenne. Pour autant, il faut noter que la France était en 2022 la première destination des étudiantes et étudiants en mobilité Erasmus+. Il est intéressant aussi de mesurer le poids des étudiants étrangers inscrits en doctorat. Bien qu’ils soient en baisse (mais très dépendants des disciplines), plus de 25 000 étrangers sont inscrits en doctorat et représentent 37% des étudiantes et étudiants qui effectuent une thèse en France. Ainsi, plus d’un tiers du travail de recherche essentiel assuré par les doctorantes et doctorants en France repose sur la mobilité internationale. La France est ainsi la 4e destination mondiale en ce qui concerne le cursus de doctorat. Cette contribution des étudiantes et étudiants étrangers est capitale pour notre pays, à la fois par l’apport direct à notre recherche, mais aussi, car elle permet de renforcer les partenariats internationaux entre équipes de recherche. Or, comme nous l’avons dit en introduction, cette coopération est primordiale pour renforcer le soft power de la France.
Dans ce rapide panorama, il faut également parler du programme Bienvenue en France, initié en 2018 sous la ministre Frédérique Vidal et contre lequel l’UNSA Éducation s’était fortement opposée8. Ce programme a conduit à des changements des conditions d’accueil des étudiants étrangers notables. S’il a permis l’introduction d’un label de qualité d’accueil, d’une simplification des démarches (guichet unique) et le développement de cours de français, il aussi introduit en 2019 des droits d’inscription différenciés pour les étudiants extra-européens (2 770 € en licence, 3 770 € en master/doctorat). Les établissements peuvent choisir d’exonérer de ces frais les étrangers jusqu’à concurrence de 10% de leurs inscrits. La grande majorité des établissements a donc décidé de ne pas appliquer ces nouveaux montants jusqu’à présent9. Cependant, avec l’accroissement du nombre d’étudiants étrangers dans les effectifs, de plus en plus d’universités sont désormais contraintes d’augmenter ces droits. Bien sûr, les droits différenciés peuvent être appliqués de manière ciblée en tenant compte des conditions sociales des étudiants, mais l’impact reste délétère et nuit à la stratégie de soft power nécessaire à la France. À celles et ceux qui contesteraient une dépense trop importante de l’État français en faveur des étudiantes et étudiants étrangers, il faut rappeler que le solde net de la présence de ces étudiants en France représente +1.35 milliards d’euros10.
- mobilité sortante :
En 2022, plus de 110 000 étudiantes et étudiants français sont allés suivre un cursus universitaire à l’étranger11. Cette mobilité sortante est en hausse de 16% en 5 ans et fait de la France le 7e pays dont les étudiants sont en mobilité diplômante dans le monde (devant les USA notamment). La destination d’étude privilégiée par les jeunes Françaises et Français reste principalement l’Europe. On retrouve ainsi dans les principaux pays choisis par les étudiants, par ordre d’importance : la Belgique, le Canada, la Suisse, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Allemagne, les USA, les Pays-Bas, la Roumanie, le Portugal, l’Italie. Les étudiantes et étudiants français sont donc particulièrement attirés par la facilité d’accès des pays européens et par les pays francophones. Notons d’ailleurs que le Canada est longtemps resté le premier pays où se rendaient nos étudiants. La Belgique, première destination lors du dernier recensement, concentre ainsi plusieurs de ces critères : proximité géographique et culturelle, francophonie, coût faible des études, mais aussi, des cursus en médecine, pharmacie ou vétérinaire particulièrement attractifs.
La spécificité des étudiantes et étudiants des pays en guerre
Le contexte des pays en guerre mérite d’être discuté à part. Il est malheureusement des régions dans le monde où étudier n’est pas ou plus possible à cause de conflits armés. On pense évidemment à des régions comme la bande de Gaza, dont les 12 universités ont été détruites par l’armée israélienne, mais aussi, entre autres, à l’Afghanistan où les femmes totalement réprimées n’ont plus le droit d’accéder à l’éducation, à la Syrie ou l’Ukraine pour ne donner que quelques exemples. Pour ces pays, c’est bien davantage un devoir de solidarité qui doit pousser la France et avec elle l’Europe à accueillir les étudiantes et étudiants. Des bourses et des programmes12 13 existent déjà mais il faut faire davantage pour ces jeunesses privées d’avenir et mieux contribuer à des futurs pacifiés. Pour mémoire, l’UNSA Éducation a porté en janvier 2025 des revendications dans le cadre spécifique du conflit au proche-orient14
Conclusion
Accueillir des étudiantes et étudiants étrangers n’est donc pas seulement un moyen de renforcer l’attractivité de nos universités. C’est un investissement diplomatique, scientifique et humaniste essentiel et cela suppose trois priorités : garantir un financement public pérenne pour éviter la dépendance aux frais différenciés, renforcer l’accompagnement et l’accueil (logement, langue, intégration sociale), développer des programmes européens solidaires, notamment pour les étudiants issus de pays en guerre. Dans un monde déboussolé, où les principes démocratiques sont contestés, la France et l’Europe ont donc la responsabilité d’ouvrir largement leurs établissements, non pas dans une logique de marché, mais bien dans celle d’un espace partagé de savoirs, de culture et de liberté.
1 Priya Gauttam, Bawa Singh, Sandeep Singh, Shankar Lal Bika, Raghavendra P. Tiwari, Education as a soft power resource: A systematic review, Heliyon, Volume 10, Issue 1,2024
2 Le classement de Shanghai est sûrement ce qui symbolise le plus cette victoire hégémonique
3 De nombreuses universités américaines comptent sur les étudiants étrangers pour payer l’intégralité des frais de scolarité. Ces étudiants sont à l’origine d’une part substantielle des revenus annuels de nombreuses universités américaines. Sur certains campus, les étudiants étrangers constituent la majorité des chercheurs dans certaines disciplines, principalement en sciences.
4 https://www.vu.edu.au/mitchell-institute/tertiary-education/university-sector-faces-losing-up-to-19-billion-due-to-covid-19
5 https://londoneconomics.co.uk/blog/publication/impact-of-the-covid-19-pandemic-on-university-finances-april-2020/
6 Zhang (张玉婷), Y., & Liao (廖钰), Y. (2021). Higher Education for International Students in China: A Review of Policy From 1978 to 2020. ECNU Review of Education, 4(4), 873-889. https://doi.org/10.1177/2096531120974382 (Original work published 2021)
7 https://chiffrescles2025.campusfrance.org/les-etudiants-etrangers-en-france
8 https://www.unsa-education.com/article-/frais-de-scolarite-des-etudiants-etrangers-non-a-la-discrimination/
9 https://www.aefinfo.fr/depeche/689915-droits-differencies-seules-13-universites-les-appliquent-completement
10 https://rapportactivite2022.campusfrance.org/analyser/135-milliard-deuros-leconomie-francaise
11 https://www.campusfrance.org/fr/actu/mobilite-etudiante-la-france-consolide-son-attractivite-dans-un-contexte-de-forte-concurrence#:~:text=A%20l’%C3%A9chelle%20mondiale%2C%20la,20%20%25%20par%20rapport%20%C3%A0%202017.
12 https://services.unhcr.org/opportunities/education-opportunities/emergency-scholarship-programme
13 https://www.etudiant.gouv.fr/fr/accueil-des-etudiants-ukrainiens-2699
14 https://www.unsa-education.com/article-/agir-au-proche-orient-par-leducation/
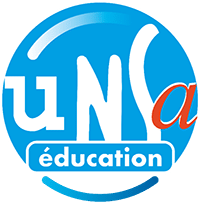
 Analyses et décryptages
Analyses et décryptages