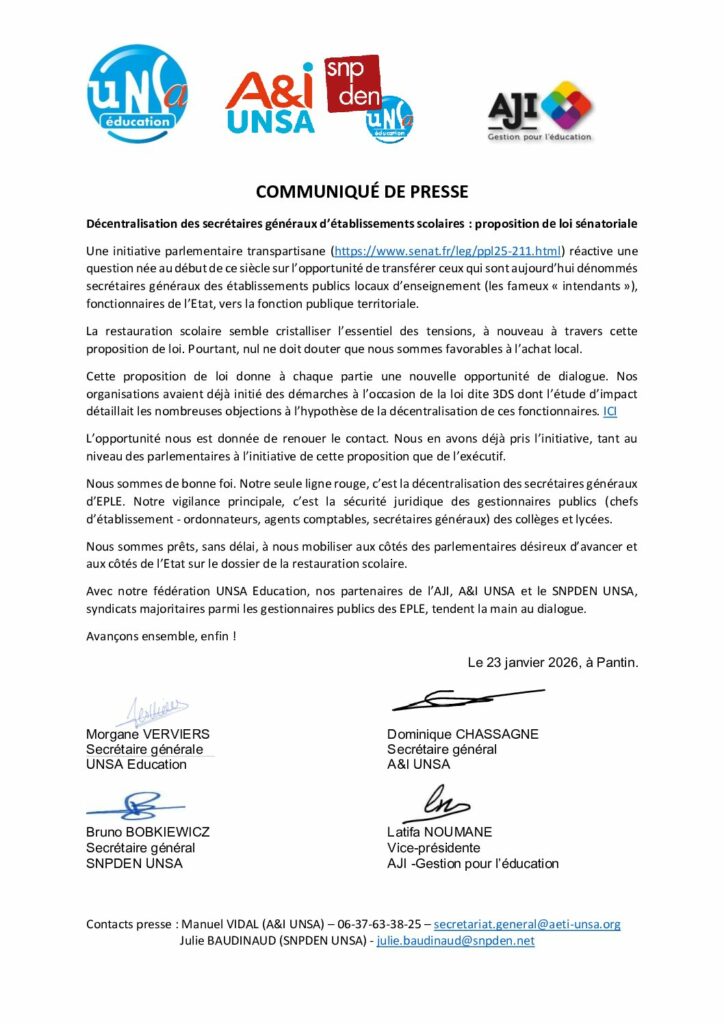La laïcité et les jeunes : 4 questions à Philippe Portier

Philippe Portier est professeur de science politique. Il est, depuis 2007, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études, titulaire de la chaire « Histoire et sociologie des laïcités ».
Il a publié de nombreux ouvrages et articles sur les laïcités, la sociologie du religieux, la relation religion/politique, la théorie politique, notamment l’État et les religions en France en 2016 ou Les jeunes et leur laïcité, avec Charles Mercier, en 2025.
Il travaille actuellement sur l’analyse comparée des régimes de laïcité et, après avoir dirigé l’enquête archivistique de la Commission Sauvé (sur les abus sexuels dans l’Église), sur les violences sexuelles dans les mondes religieux.
Contrairement à ce que l’on peut souvent entendre, peut-on dire que les jeunes sont attachés à la laïcité ?
L’enquête de Philippe Portier et Charles Mercier a révélé que les jeunes connaissent et apprécient les principes de laïcité, notamment la liberté de conscience et la neutralité de l’État. Cela suggère une meilleure intégration générationnelle que ce que l’on pensait initialement. Les jeunes démontrent une compréhension des principes fondamentaux de la laïcité, bien qu’ils ne soient pas spécialistes du droit des cultes. L’enquête suggère que la laïcité pourrait être perçue un principe de rassemblement des générations plutôt qu’une source de fracture sociale.
Quel rapport la jeune génération entretient-elle avec le principe de laïcité ?
Les chiffres de votre enquête révèlent une grande méfiance de la jeunesse quant à l’instrumentalisation du principe de laïcité…
Pour Ph Portier, les jeunes ne rejettent pas le principe de laïcité en tant que tel, mais critique sa manière d’être appliquée, particulièrement concernant les interdictions de signes religieux comme le voile. Il souligne que les jeunes peuvent considéré certaines mesures ou certains discours comme pouvant porter atteinte à la liberté individuelle plutôt que promouvoir la cohésion sociale. L’auteur mentionne également que les jeunes montrent une grande sensibilité au principe d’égalité, un point qui avait été observé dans de nombreuses enquêtes précédentes.
Les jeunes revendiquent l’importance de l’égalité et le refus des discriminations, tout en critiquant ce qu’ils considèrent parfois comme des discours relevant d’une « obsession musulmane ».
Comment la perception de la laïcité a-t-elle évolué ces 30 dernières années ? Comment la jeune génération percoit-elle la laïcité enseignée au regard de sa confrontation à la réalité de la promesse républicaine ?
Pour Philippe Portier, la laïcité a évolué en France depuis les années 1990, passant d’un paradigme de diversité et de pluralité à une approche plus restrictive en particulier pour ce qui concerne les signes religieux. Les plus jeunes manifestent à la fois une protestation contre les restrictions sur les signes religieux et une loyauté envers les disciplines sociales, sans adopter de comportements de sécession significatifs. Philippe Portier note d’ailleurs que peu de jeunes ont choisi de fréquenter des établissements confessionnels comme alternative, tandis que la plupart sont restés dans le système public malgré leurs réserves.
Malgré certaines déceptions, les jeunes maintiennent un attachement à l’école publique grâce à l’appréciation des professeurs et du tissu moral transmis, plutôt que par simple loyauté institutionnelle. Les jeunes se situent sur un équilibre entre leur liberté individuelle et les valeurs transmises par la famille et l’école, montrant une gratitude envers les médiateurs sociaux qui les ont formés.
L’enquête a également révélé que les jeunes sont très tolérants en matière de liberté religieuse, bien qu’ils se considèrent moins religieux que leurs aînés, reflétant la sécularisation de la société.
Les jeunes de 18 à 30 ans sont moins liés aux institutions religieuses que leurs parents, ils montrent une plus grande adhésion aux croyances religieuses, particulièrement en ce qui concerne la croyance en Dieu et des concepts comme l’enfer et le paradis. Pour autant, ces jeunes sont plus libéraux sur certains sujets comme l’interruption volontaire de grossesse.
Peut-on parler d’une pluralité de la jeunesse, en particulier dans son rapport à la laïcité ?
Une segmentation de la jeunesse selon les appartenances religieuses, la classe sociale, le niveau de diplôme et les différences de genre a été mesurée dans l’enquête.
Les travaux en sociologie montrent en effet que les variables sociales lourdes continuent de déterminer les comportements des jeunes, contrairement à la théorie du choix rationnel individuel des années 1990. Pour Philippe Portier, les femmes sont plus progressistes que les hommes. Par ailleurs, le niveau d’éducation, la classe sociale et l’appartenance religieuse influencent les positions sur la laïcité, avec des diplômés plus attachés au principe de laïcité et plus tolérants que les non-diplômés.
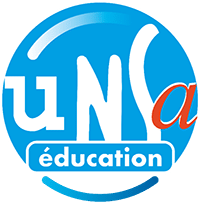
 Nos dossiers
Nos dossiers