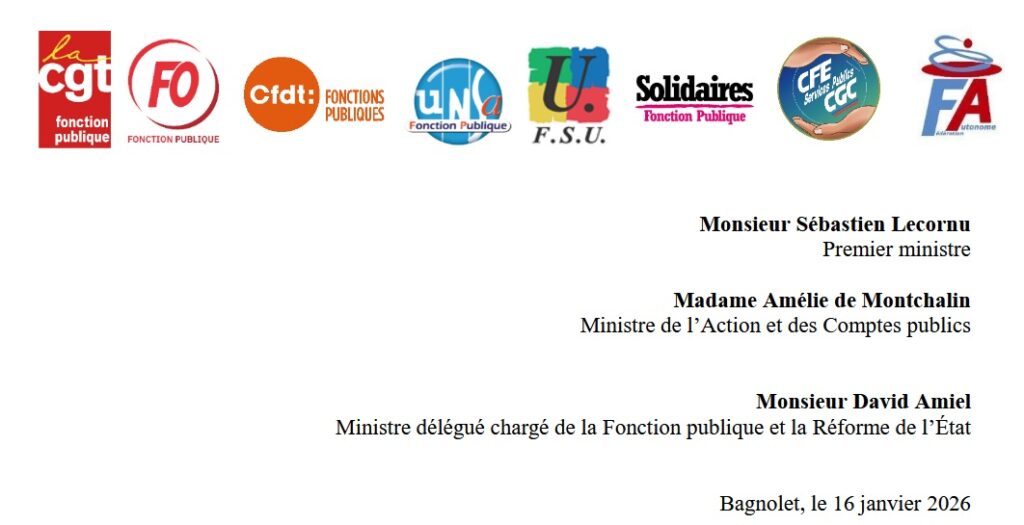Jeunesses populaires rurale et urbaine (3) : le genre, un facteur qui accroît les inégalités

Benoît Coquard, sociologue spécialiste des jeunesses rurales¹ et grand invité du colloque, le reconnaît volontiers. « Pour elles [les jeunes femmes], ça peut être plus compliqué. Quand tu es diplômée, on te zappe. Les jeunes hommes du village qui sont devenus artisan, pompier professionnel ou sont entrés à l’armée font figure de réussite sociale. Par contre, la jeune femme qui a fait un master, qui travaille aux ressources humaines dans une grande boîte, tout le monde s’en fout. Elle n’arrive pas à imposer ce modèle de réussite là. Il y a une violence pour elle qui objectivement a réussi mais qui n’est pas reconnue dans le milieu qui compte pour elle. »
Un retour au pays d’autant plus difficile à vivre pour ces jeunes filles que leur départ est souvent plus subi que souhaité : « ces jeunes femmes ont joué le jeu scolaire, poursuit Benoît Coquard. Elles étaient les premières générations de leur famille à aller à la fac et n’avaient pas envie de partir dans les études. Ou elles avaient un tel attachement à leur territoire que c’était partir pour pas longtemps ».
Déterminismes sociaux
Invitée à témoigner sur ce phénomène, Salomé Berlioux² est fondatrice de l’association Rura dédiée à la jeunesse rurale. Elle évoque un programme développé par son association entièrement dédié à accompagner les jeunes filles des ruralités, « pour lutter contre ce qui peut être un triple déterminisme social, géographique et de genre, quand vous êtes une jeune fille de milieu modeste qui grandit à la campagne ». Les résistances à l’émancipation sont multiples, notamment sur les questions intimes liées à la santé et à la maternité dans des petites localités où les familles sont connues et repérées.
Autre thème évoqué, l’orientation scolaire grevée par l‘éloignement géographique et les nombreux interdits liés aux déterminismes sociaux, plus ou moins conscients, qui demeurent dans l’esprit de ces jeunes femmes en matière de choix d’études, de parcours professionnel. La question financière et matérielle contraint davantage encore les décisions de faire des études courtes plutôt que longues, et réduit donc les choix des filières, forcément loin du domicile familial. Difficulté qui n’épargne pas les filles des classes moyennes rurales et CSP + confrontées à la culture professionnelle de leur environnement : « vouloir devenir entrepreneuse, ça s’entend, mais dans la high tech, c’est forcément plus compliqué », explique en substance Salomé Berlioux.
Moins visibles que les hommes
Autre sociologue, des jeunesses féminines rurales, Yaëlle Ansellem-Mainguy³, témoigne sur le site de l’Afev, de bien d’autres freins à cette émancipation féminine. Tout en dressant un portrait de ces jeunes femmes pourtant bien de leur époque. Moins visibles que les jeunes hommes car « faisant moins de politique » ou étant « plus rares dans les clubs de sport ou de chasse », ce sont des jeunes femmes connectées aux réseaux sociaux, mais enclines à demeurer chez elles pour plusieurs raisons.
« Elles ne rêvent pas de vivre dans une métropole, et encore moins à Paris, vu comme un lieu hyperpolarisé, avec les ultra-bourgeois d’un côté et les racailles de l’autre ». De plus, en restant « au village », elles confortent une certaine forme d’organisation familiale qu’elles risquent de déséquilibrer en partant. Et elles bénéficient sur place d’emplois peu qualifiés mais disponibles alors que la ville, lieu peu désiré, est très incertain en termes d’emploi. Néanmoins, dans leur territoire, l’offre de formation et d’emploi est très genrée ; elles se tournent principalement vers les métiers du soin, de la petite enfance, de la vente, qui recrutent souvent en intérim, en CDD. Ce qui engendre instabilité et fragilité, renforcées par un manque de services publics nécessaires pour elles : gynécologie, mission locale, poste, etc.
Leur rêve résidentiel donc ? Vivre dans un centre bourg où l’on peut faire des courses et se passer de transports en commun. Conscientes qu’elles doivent être autonomes économiquement, leur entrée dans la vie active est plus précoce que les jeunes urbaines et les confronte rapidement à cette situation sociale de précarité plus ou moins durable.
L’égalité face au droit est donc pour elles un enjeu double ; celui d’une possibilité de choisir un meilleur avenir, par l’éducation, l’orientation, la formation, tout en préservant leur fort attachement à leur territoire, et celui de concourir à ce meilleur avenir au même titre que les jeunes hommes des milieux populaires ruraux, sans discrimination de genre. L’UNSA Éducation partage pleinement ces valeurs d’égalité entre les genres et les territoires et plaide pour toutes les initiatives – notamment publiques – qui permettraient à cette ambition de se réaliser.
Liens bibliographiques
¹ Benoit Coquard : « Ceux qui restent »
² Salomé Berlioux : « Celle qui part»
³ Yaëlle Ansellem-Mainguy : « Les filles du coin »
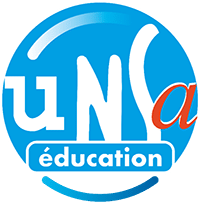
 Nos dossiers
Nos dossiers