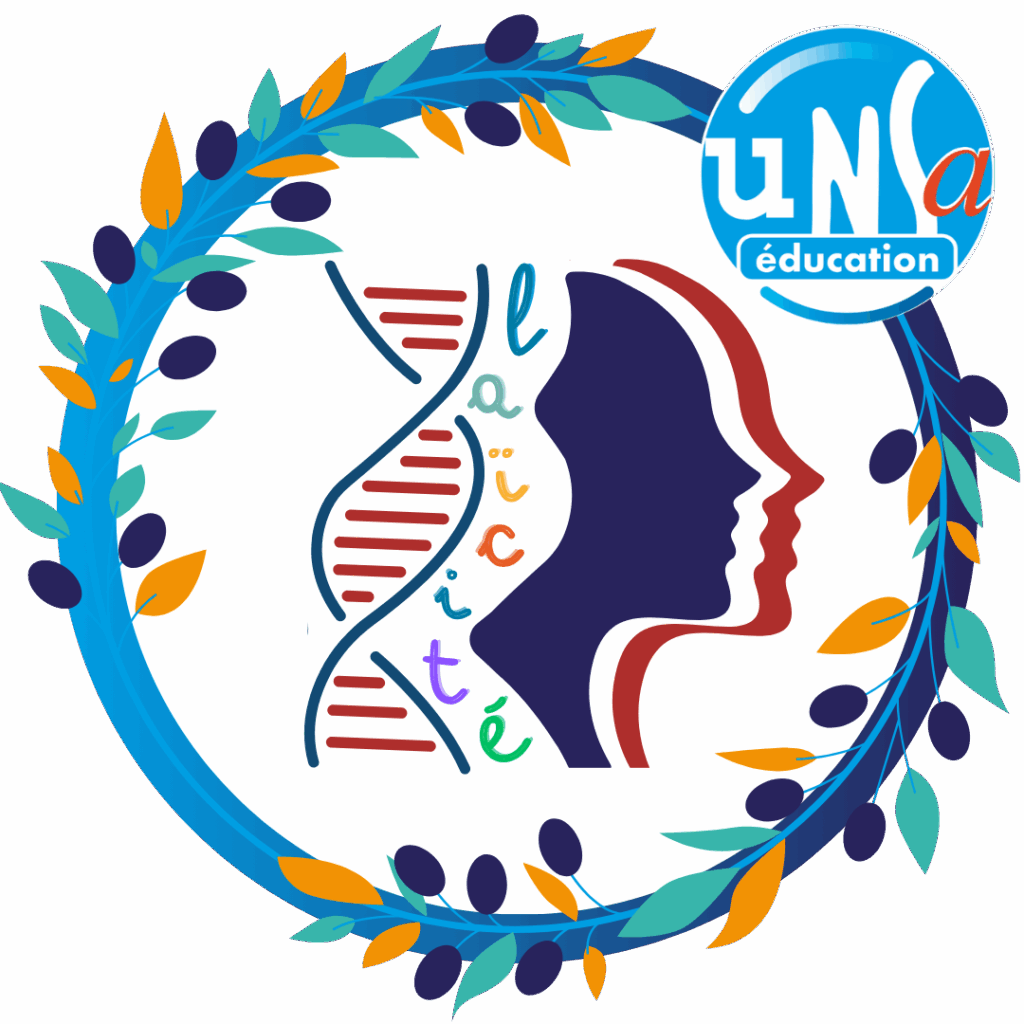Jeunesses populaires rurale et urbaine (1) : vers une convergence des luttes

La double réalité des jeunes ruraux d’une part et urbains d’autre part, Benoît Coquard*, la connaît bien. Ce sociologue, spécialiste des jeunesses rurales et originaire de la Haute-Marne, était le grand témoin de cette journée. Pour lui, il est temps de récuser l’instrumentalisation qui a été faite par le politique de cette opposition entre deux jeunesses que tout semblerait différencier à première vue.
« Les jeunes de milieu populaire urbain ont été suspectés d’avoir touché trop de subventions de la rénovation urbaine et il fallait trouver une autre jeunesse, plus légitime à défendre, et nous, jeunes ruraux, on était tout désignés pour ça. », a rappelé Benoît Coquard. « Personne n’était venu demander leur avis aux jeunes ruraux sur la manière dont ils voulaient se définir, comment ils voulaient qu’on parle d’eux », renchérit-il, pointant toute une communication politique à la mode sur la ruralité, tout un discours électoral qui « permet de gommer une certaine distance sociale. La ruralité est devenue vraiment un faire valoir et fait souvent écran de fumée à tout un tas de questions sociales. »
La campagne, un truc de parisiens
« La campagne, c’est un truc de parisiens en fait. Il y a la permanence d’une vision très homogénéisante de la campagne. » Quant au drame de Crépol, c’est un évènement qui « dicte aujourd’hui la manière dont les jeunes ruraux et les jeunes de banlieue doivent se voir. C’est-à-dire comme des ennemis qui s’assassinent », déplore le sociologue en s’adressant à Yvon Atonga**, autre invité issu, lui, des banlieues. « Avant, vous [les jeunes des banlieues] nous ignoriez et vous nous étiez vaguement lointain. Il fallait un peu vous ressembler quand on était entre nous [les jeunes ruraux]. Devant maman, on coupait Skyrock et on remettait NRJ. Puis on rabaissait le jogging. Alors que maintenant il y a une vraie désignation d’un ennemi. En tout cas pour les jeunes ruraux qui grandissent, on leur dit : « Attention à ces jeunes ». Et là, on est encore passé à une autre étape de polarisation, de fracture sociale, orchestrée à grands coups de relais médiatique.
« C‘est vrai que le drame de Crépol a créé vraiment une scission entre les jeunes ruraux et ceux qui grandissent dans les quartiers populaires », répond Yvon Atonga. Je suis parti intervenir là-bas pour essayer d’échanger avec les jeunes. Je pense qu’au fur et à mesure, avec le temps, ils vont comprendre qu’ils ont les mêmes problématiques, qu’il faut essayer d’avancer ensemble plutôt que divisés. Parce que le problème de la reproduction sociale vaut pour un groupe comme pour l’autre. »
Destins liés
Faire prendre conscience d’une communauté de destin et converger les luttes de ces deux populations artificiellement mises en concurrence, tel est le défi de l’association Destins liés présidé par Achraf Manar également présent à la journée de l’Afev. Celui-ci a connu également ces deux vies, en cité à Bordeaux et dans les campagnes profondes de la Haute-Loire. Pour lui, ces jeunesses qu’on oppose ont en fait un sens profond de l’engagement. « Les jeunes ne sont pas que des bénéficiaires, plaide-t-il en référence aux allusions de certaines mauvaises langues qui estiment qu’on a déjà financé beaucoup d’actions et de dispositifs en leur faveur. « Les jeunes sont engagés d’une manière ou d’une autre dans la vie de la cité. Mais ils ne le formulent pas comme ça. Ceux qui font tourner la bonne ambiance et les grandes fêtes du village, les endroits où il y a de la liesse populaire où les gens se rencontrent, sortent de l’individualisme, c’est organisé par les jeunes. Le fait de passer d’une vision de bénéficiaire à une vision d’acteur, ça change tout. » Et de déplorer que ces mêmes jeunes, très actifs et volontaires, engagés, sont rarement en position d’être reconnus comme tel. « Il y a moins de 4 % de présidents d’association qui ont moins de 30 ans. C’est dire la part minime de celles et ceux qui sont issus de milieu populaire. »
« Notre objectif est de soutenir des collectifs de jeunes portés par des jeunes, premiers concernés en quartier populaire, en milieu ruraux, en territoire ultramarin, mais aussi des collectifs de jeunes qui ne rentrent pas dans ces cases, renchérit Achraf Manar. Notre postulat est dans notre nom : destins liés. On a un destin commun de ce point de vue là. On a des enjeux communs et on a donc besoin de construire un espace pour se retrouver, dans lequel on apporte des ressources à ces collectifs. Financement, formation, espaces d’entraide pour se partager les peurs et les rires de façon générale. C’est ça l’objectif. »
L’UNSA ÉDUCATION s’associe pleinement à ces témoignages et ces propos visant à réconcilier et fédérer les jeunes des classes populaires des villes et des ruralités et dénonce toute tentative de les opposer pour alimenter une fracture sociale et territoriale. Cette opposition, toute artificielle sur le fond, n’a pas lieu d’être. Ces jeunes, qu’ils soient des villes ou des campagnes, sont soumis aux mêmes besoins d’être aidés et encouragés, même si chaque population vit des inégalités éducatives et d’insertion spécifique. L’enjeu de l’égalité des chances les rassemble davantage qu’elles ne les opposent, dans la visée d’un autre défi républicain : l’égalité des territoires et la cohésion de la nation.
Il est impératif que les moyens nécessaires affectés aux politiques publiques de la jeunesse, encore très insuffisants et géographiquement inégaux, soient justement répartis en tous points du territoire.
* Benoît Coquard est l’auteur du livre « Ceux qui restent » qui décrit la vie quotidienne de celles et ceux qui ont choisi de rester vivre dans les campagnes.
** Yvon Atonga est co-auteur du livre « Petit frère » avec la sociologue Isabelle Coutant, livre qui cherche à comprendre les destins si différents de deux frères (Yvon, celui qui a réussi, et Wilfried, son jeune frère assassiné) ayant grandi dans la même cité.
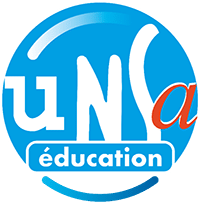
 Nos dossiers
Nos dossiers